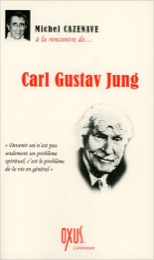Ma première rencontre avec Jung
C’est dans ma vingt et unième année que j’ai rencontré Jung.
Bien entendu, je n’en avais jamais entendu parler durant mes études, et lorsque je « tombai » sur lui, je ne savais même pas qu’il existait quelqu’un de ce nom.
De fait, l’un des plus grands analystes jungiens des années 1970 et 1980, Pierre Solié nommément, avait coutume de dire, se référant à l’évidence au titre si fameux de Jacques Monod, qu’il avait rencontré Jung « par hasard et par nécessité ». J’aimerais quant à moi inverser la formule, car je devrais dire, à strictement parler, que j’ai trouvé Jung « par nécessité et par hasard ».
Par une nécessité intérieure à laquelle répondit, comme l’appelait Claudel, une « jubilation des hasards ». Mais il faut, certainement, que je m’explique sur ces termes.
Il se trouve que, juste après mon vingtième anniversaire,
je fus reçu au concours d’entrée de l’École normale supérieure. Non point d’ailleurs que j’eusse fait ce qu’il fallait dans ce but (je fréquentais beaucoup plus les salles de cinéma que je ne m’attablais à mon bureau) – mais enfin, apparemment, les dieux l’avaient voulu, et surtout, je pense, la grâce de Michel Foucault, qui était l’un de mes deux examinateurs à l’épreuve de philosophie.
Toujours est-il que, comme on parle d’une « névrose d’échec », il existe aussi sans doute une « névrose de succès » – et que, précisément, je ne pouvais supporter un succès dont j’eus tôt fait de découvrir les racines et la véritable signification.
Il se trouve en effet que, issu d’une famille typiquement IIIe République (mon arrière-grand-père paternel était un tout petit roulier de la base, mon grand- père accéda à l’enseignement et devint directeur d’école, et mon père était polytechnicien), j’avais été requis de réussir mes études et d’intégrer Polytechnique à mon tour. Littéraire dans l’âme, même si j’avais aussi de bons résultats dans les matières scientifiques, je ne pouvais acquiescer à cet ukase qui m’était imposé. En classe de Math élem, je m’étais donc arrangé (en réalité, il n’y avait rien de plus facile) pour échouer lamentablement à mes compositions trimestrielles : on avait du coup été bien obligé de me faire « descendre » en philo, ce que je visais justement.
Or, quand je fus reçu à l’ENS, je compris bien vite que j’avais exactement fait ce que l’on attendait de moi : Polytechnique ou ENS, qu’importait en réalité ? Ce que voulait mon père, c’était que je fusse reçu à l’une des plus grandes écoles françaises – et je n’en avais pas pris conscience auparavant !
Dès que je m’en rendis compte, imaginez le drame que je vécus, moi qui étais un « rebelle professionnel », et la profonde dépression dans laquelle je plongeai.
Pour en donner toute la mesure, je dois ajouter que je ne m’étais jamais senti une grande vocation de « fils œdipien », même si ma famille, à l’évidence, relevait de ce régime. Alors, non seulement avoir obéi, mais avoir obéi à mon père, c’était insupportable !
Car il faut bien dire que, dans un registre que j’étais incapable de déterminer, je me voulais d’abord un « fils de ma mère ». Je militais à l’époque pour un changement de la loi sur les patronymes, tenant que tout enfant aurait dû porter le nom de sa mère. Mater certissima, pater semper incertus : on connaît le vieil adage romain qui signifie que la mère est tout à fait certaine – et pour cause ! – alors que le père est toujours incertain, devant bien se fier en la matière à l’attestation que lui en donne sa femme ; on ne connaissait pas alors les tests ADN, et si je ne doutais pas une seconde de la légitimité de mon père, quelque chose de confus en moi acquiesçait profondément à une telle déclaration. Je ne me pensais donc moi-même que comme l’héritier de ma lignée maternelle.
Ce qui voulait dire tout autant que j’avais intériorisé le fardeau que ma mère portait sur ses épaules : elle n’avait pas sept ans qu’elle avait déjà vu mourir ses deux frères et sa propre mère, elle n’en avait pas vingt-neuf que son premier enfant était décédé, noyé dans la Méditerranée par un jour de beau soleil.
Ainsi marquée par la mort (je l’ai entendue rapporter plus tard comment, après la disparition de mon frère aîné, elle s’était livrée avec fureur à l’entretien de sa maison afin, déclarait-elle, de ne plus penser et de ne pas devenir folle), et même si elle avait toujours fait attention de ne pas le montrer, elle était d’une nature profondément mélancolique que traversaient parfois de grands accès de révolte : « Si Dieu existe, il est mauvais », combien de fois ai-je entendu cette protestation qui montait du plus profond de son âme !
Mais ce n’était pas tout : ce frère mort, j’étais né pour le remplacer. Il suffit d’ailleurs de comparer la date de ma naissance avec celle de sa mort (onze mois de différence !) pour le comprendre d’un coup d’œil. Heureusement, on ne me l’avait jamais caché, en sorte que je n’avais pas eu, au moins, à en porter le poids dérobé. Il n’en reste pas moins que, tout au long de ma jeunesse, je n’ai jamais été très sûr d’exister.
Au fond, étais-je bien moi-même ou n’était-ce pas « lui » qui vivait à travers moi ?
Enfin – comme si cela ne suffisait pas ! –, je dois ajouter qu’à deux ou trois semaines de mon anniversaire de dix-sept ans, j’étais « tombé » follement amoureux d’une jeune fille d’un an à peine ma cadette ; ç’avait été, pendant une année tout entière, la plus profonde félicité – jusqu’à ce que mon père, ma mère au second plan, se décidât à me convoquer et à m’intimer l’ordre de cesser une relation aussi fâcheuse. La raison en était des plus simples : elle m’empêchait de travailler ! Sur le moment, écrasé d’une telle sentence, je n’avais pas pensé à réagir et à faire remarquer que je venais d’obtenir le prix d’excellence de ma classe de terminale dans ce qui était alors considéré comme le premier lycée de France. Drôle de manière, en vérité, de ne pas assurer mes études ! Toujours est-il que j’avais obéi sans discuter. J’avais mis fin à mon amour (enfin, je le croyais), et dans une protestation silencieuse (il y avait bien quelque chose qui marquait confusément son désaccord tout au fond de moi), j’avais suivi les cours qui m’étaient destinés en y prenant toutefois une distance bien cachée de ma famille : ce devait être mon côté rebelle qui s’exprimait de la sorte, ce côté qui me donnait au moins l’impression que j’existais réellement.
Je me rappelle ainsi ce professeur d’anglais qui nous avait donné à faire une dissertation sur Shakespeare et, plus généralement, sur le théâtre élisabéthain. Je m’étais procuré pour l’occasion les textes de Frances Yates (c’était encore l’époque où on ne les connaissait pas en France), et j’avais bâti tout mon devoir à partir d’eux. Le digne magister, malheureusement, ne les connaissait pas quant à lui, et il en était demeuré aux vues les plus classiques de la critique littéraire. Il avait donc trouvé (légitimement, de son point de vue) que j’étais devenu délirant, et m’avait gratifié d’une très mauvaise note. J’étais incontinent allé le trouver, et m’étais gaussé de lui pour ce qu’il ne se tenait pas au courant des dernières recherches menées outre-Manche. Je lui avais déclaré tout de go que, puisqu’il en allait ainsi, je ne lui rendrais plus une copie d’ici la fin de l’année. Ce que je fis scrupuleusement – et n’aurais-je pas dû me demander si une certaine façon de s’opposer n’était pas une manière de se poser soi-même, et de quoi une insolence aussi prétentieuse était le signe ?
Toujours est-il que, une fois débarrassé de mon concours, et mes « efforts » couronnés de succès, tous ces problèmes accumulés me revinrent comme un boomerang à la figure.
Entre l’autorité affichée par mon père et ses souhaits inexprimés auxquels j’avais répondu presque au-delà de toute attente, la mélancolie maternelle et mon amour perdu, il y avait bien de quoi entrer dans une dépression profonde. Ce que, sans en avoir conscience, je m’étais empressé de faire.
Je me retrouvai ainsi sans plus aucun goût à la vie, accablé d’une fatigue et d’une tristesse incompréhensibles, taraudé par des insomnies qui eurent tôt fait de devenir chroniques.
Des éblouissements me prenaient en pleine rue, mon cœur battait à tout rompre et je me sentais souvent comme sur le point de m’évanouir.
En sorte que, sauf pour le strict nécessaire, je pris l’habitude de ne plus sortir de la chambre d’étudiant que j’occupais au septième étage d’un immeuble 1930.
Pire encore, moi qui ne rêvais pas d’habitude (ou qui du moins ne me souvenais pas de mes rêves), pour le peu que je dormais, je commençai à faire des cauchemars qui me poursuivaient ensuite la journée tout entière. Surtout un, récurrent, qui ne voulait pas me lâcher : il insistait tellement que j’eus vite fait de comprendre que s’y disait quelque chose d’essentiel – mais quoi ?
Dans ces nuits de folie, je voyais en effet la déesse Kali - comment savais-je que c’était elle ? je le savais, c’était tout - je voyais donc Kali s’approcher de moi, me planter ses dents dans la gorge, et dans une espèce de jouissance vampirique, aspirer tout mon sang comme s’il s’était agi d’un festin de pieuvre ou d’araignée. À l’état de quasi-cadavre (mais elle n’allait jamais « trop loin » afin de me garder en vie, aussi peu que ce fût), je la voyais s’éloigner en ondulant des hanches et, quand elle se retournait vers moi, j’apercevais sur-le-champ le rictus de ses lèvres qui dégouttaient de mon sang.
Une horreur me saisissait alors, qui me réveillait du même coup, et me laissait pantelant, inondé de sueur, dans le noir environnant.
Pourtant, je savais aussi qu’il y avait là un plaisir inouï, et cette jouissance me faisait sans doute aussi peur que le funeste carnage auquel j’assistais sur moi-même.
(Je me demandai plus tard comment j’avais pu deviner cette bave sanguinolente de la Déesse puisque, à l’époque, je ne savais rien d’elle : ce ne fut que plus tard, quand j’en eus « compris » la figure, que je m’intéressai à elle et que je lus tous les textes qui me tombaient sous la main et qui pouvaient la concerner.)
Bref, entré dans cette profonde mélancolie, je souffrais tant et plus, et ignorais comment m’en sortir. Je m’analysais sans fin, je traquais les moindres de mes actes ou paroles manqués – et si j’eus tôt fait de comprendre que la figure de la jeune fille perdue hantait mon inconscient, que je pleurais au fond de moi sa disparition et que quelque chose dans mon cœur la réclamait à cor et à cri, je n’en pressentais pas moins qu’il ne suffisait pas de la retrouver, mais qu’il fallait encore libérer son image de... je ne savais trop quoi au juste.
J’en eus vite la confirmation : comme j’avais pris l’habitude de me promener dans le quartier qu’elle habitait, je finis forcément par la croiser un soir. Enfin, disons plutôt qu’elle venait du métro pour regagner ses pénates, qu’elle m’aperçut de dos, et que, prise d’un soudain sentiment de panique (c’est ce qu’elle m’avoua par la suite), elle s’était mise à courir pour me dépasser en faisant mine de ne pas me reconnaître, en sorte qu’elle n’eût pas ainsi à engager une conversation avec moi.
Je l’avais bien sûr reconnue immédiatement, ne fût-ce qu’à ses cheveux blonds qui balançaient dans son dos, à sa façon de se tordre les chevilles sur ses talons trop fins, et à la minceur de sa taille que soulignait sa ceinture. De toute manière, aurais-je pu hésiter ? Je savais que c’était elle, tout mon être le disait, je n’avais de désir que de la prendre dans mes bras et de la couvrir de baisers – et pourtant, je n’eus pas de réaction, je la laissai s’enfuir sans tenter un seul geste ; je cessai même de marcher pour la laisser prendre la distance qu’elle jugeait nécessaire, parce que je savais, dans quelque tréfonds obscur de mon âme, que l’heure n’était pas venue et que je n’étais pas en mesure de m’offrir tout à elle comme il l’aurait vraiment fallu si nous avions dû nous retrouver...
Michel Cazenave
Si cet extrait vous a intéressé,
vous pouvez en lire plus
en cliquant sur l'icone ci-dessous