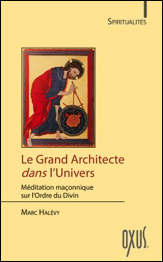De la cohérence et de la cohésion universelles
Tout, ici-bas, est impermanent. Tout est mutation, transformation, évolution. Rien n’est fixe. Rien n’est immuable. Et, cependant, tout est cohésif et cohérent ; tout est Un.
La première des régularités universelles est que tout est interdépendant de tout, que tout est dans tout, que tout interagit avec tout, que tout est cause et effet de tout.
L’univers, pris comme un tout, est une unité organique. Cette conclusion essentielle – aux consonances et conséquences métaphysiques infinies – est aujourd’hui, le point de convergence fort entre les spiritualités et mystiques de toujours et les modèles les plus récents de la cosmologie « complexe ».
C’est précisément parce que l’univers pris comme un tout est une unité organique que la Table d’Émeraude et les théories des correspondances et des « signatures » font sens.
Ne serait-ce que par effet de la loi gravitationnelle de Newton, le moindre mouvement de mon petit doigt influe sur les orbites de tous les astres du ciel astronomique. Influence infime, infinitésimale, négligeable sûrement, mais influence réelle.
Cette perspective est affolante... surtout si l’on songe aux dégâts macroscopiques que l’activité humaine engendre sur la Terre et dans le Ciel.
L’univers comme unité organique induit deux principes complémentaires (en fait les deux faces d’un même principe unique d’organicité, précisément) : celui de cohérence et celui de cohésion. La cohésion dans l’espace et la cohérence dans le temps.
La cohésion dans l’espace est l’expression spatiale de l’unité organique de l’univers : tout est lié à tout et interdépendant de tout.
La cohérence dans le temps en est l’expression temporelle : tout est cause et effet de tout.
Cette cohérence et cette cohésion induisent une idée simple : il n’y a pas de hasard. Pour paraphraser Jean Rostand qui, lui, parlait de l’instinct : le hasard, c’est la poubelle de nos ignorances. Il n’y a pas de hasard. Mais il n’y a pas plus de nécessité (voir mon Ni hasard, ni nécessité, Oxus, 2013). Le hasard implique l’indétermination absolue. La nécessité implique le déterminisme absolu. La réalité est ailleurs. Elle se pose entre ces deux extrêmes, ni existentialiste, ni essentialiste. Elle emprunte une autre voie : celle des possibles. Le nombre et la nature des possibles ouverts à chaque instant sont déterminés, mais le choix de l’un ou l’autre d’entre eux ne l’est pas. Et ce choix n’est point affaire de hasard, mais bien d’intention.
L’univers est une intention en marche, une volonté en cours d’actualisation, un désir en voie de réalisation. Cette intention cosmique n’est pas le caprice d’un Dieu créateur étranger à l’univers qui serait, en somme, comme son œuvre. Dieu n’est pas un Grand Sculpteur transcendant et extérieur au monde qui sculpterait un univers d’une autre nature que lui, et hors de lui. Dieu est un Grand Architecte immanent et intérieur au monde : il est le Grand Architecte dans l’Univers. Il est l’Âme de cette unité orga- nique en évolution, de cet univers en expansion, en complexification, en accélération.
Panthéisme ? Oui. Panenthéisme ? Aussi. Naturalisme ? Extrêmement. Animisme ? Pourquoi pas. Spinozisme ? Admirablement. Écossisme ? Assurément. Kabbalisme ? Oui, dans ses profondeurs. Alchimisme ? De même. Védantisme ? Oui, en Inde. Taoïsme ? Oui, en Chine. Shintoïsme ? Oui, au Japon.
Et des noms de penseurs admirables fusent : Héraclite d’Éphèse et l’école de Milet (Thalès, Anaximandre, Anaxagore, Anaximène...), Lao-Tseu, Xénophon, Tchouang- Tseu et Lie-Tseu, Aristote (parfois), Shankara, Maître Eckhart et les mystiques rhénans, Baroukh Spinoza, Giordano Bruno, Pascal (de temps en temps), Hegel (sous certains angles), Schelling, Nietzsche, Pierre Teilhard de Chardin, Albert Einstein, Vivekananda et son disciple Sri Aurobindo, Heidegger (malgré ses flous), Marcel Conche (sans doute), et tant d’autres...
Les ennemis mortels ? Empédocle, Démocrite, Pytha- gore, Platon, Augustin d’Hippone, Thomas d’Aquin, Descartes, Kant (et ses obscures « Lumières »), Fichte, Comte, Kierkegaard, Sartre... et pas mal d’autres.
Le spiritualisme moniste décrit ici n’est ni l’idéalisme, toujours dualiste puisqu’il oppose le monde réel et le monde idéal (ou divin), ni le matérialisme (ou hasardisme) qui nie toute intention, tout sens (dans les deux acceptions de direction et de signification), toute cohérence dans le temps et toute organicité cohésive dans l’espace.
La philosophie occidentale, presque toujours, a voulu dualiser la pensée entre idéalisme et matérialisme et a voulu, sciemment ou non, ignorer ou, du moins, occulter la troisième pointe du triangle : le spiritualisme moniste qui, pourtant, directement ou indirectement, explicite- ment ou implicitement, guide la plus grande part du genre humain depuis les premières aubes de la pensée et les premiers cultes rendus à la Déesse-Mère.
Classiquement, l’histoire de la philosophie occidentale est dessinée comme une vaste dialectique entre Démocrite (le matérialiste) et Pythagore (l’idéalisme, Maître de Platon). Il reste alors, sur le carreau, une foule de penseurs dits « inclassables » parce qu’ils n’entrent pas dans ce moule étroit de la dualité académique. J’en ai cité quelques-uns plus haut.
Ne quittons pas ce terrain de l’unité organique de l’univers et de sa cohérence temporelle et de sa cohésion spatiale sans faire un détour philosophique essentiel sur les notions de cause et d’effet, car la relation de cause à effet est partout, en science comme en philosophie, au centre du débat sur la cohérence universelle. Voyons...
Toutes les sciences (c’est d’ailleurs cela qui les définit) se fondent sur le principe de causalité : comprendre un phénomène, c’est en décrypter les causes et leurs enchaînements logiques et quantitatifs.
L’idée centrale affirme que tout phénomène résulte d’un petit nombre fini de causes identifiables qui sont siennes et qui s’enchaînent linéairement.
Cette idée élémentaire est fausse : un phénomène, quel qu’il soit, résulte non de quelques causes précises et identifiables, mais de la convergence d’un nombre infini de processus parallèles dont le phénomène observé n’est que la résultante et la manifestation locale. Tout phénomène local résulte de la convergence, à cet endroit, à cet instant, de l’ensemble de tous les processus en cours, depuis l’origine des temps, au sein de l’univers.
Rien ne se passerait si tout – absolument tout – ce qui s’est passé ne s’était pas déjà passé (c’est la généralisation de la conjecture d’Ernst Mach).
Exemple : « Jean, en colère, ramasse un gros caillou et le lance vers la vitre de la chambre d’Émilie ; cette vitre, sous le choc, vole en éclat. »
La chaîne causale paraît évidente : colère → jet → bris. Si l’on en reste là, on ne comprend rien à la réalité glo- bale des choses, car pour que cette rudimentaire chaîne causale puisse rendre compte réellement du phénomène, encore faudrait-il expliquer aussi comment ce caillou se trouve là, d’où il vient, de quel processus géologique il émane ; encore faudrait-il expliquer comment la gravitation terrestre a incurvé la trajectoire du caillou et quelles sont la source et les modalités de cette gravitation ; encore faudrait-il expliquer pourquoi et comment s’instaure un processus colérique chez les primates, le relier aux atavismes et aux mémoires phylétiques, aux processus d’éducation et d’apprentissage, à toutes les influences naturelles et culturelles qui ont fait de Jean un garçon coléreux, et pourquoi et comment cette colère se mue en violence physique, qui s’exprime symboliquement par le désir de briser la vitre qui fait écran, malgré sa transparence, entre Jean et Émilie...
Inutile, je pense, de continuer à scruter l’ensemble de tous les processus immémoriaux qui doivent converger pour que la vitre se brise (je n’ai pas fait allusion, par exemple, au fait incroyable que la maison d’Émilie soit là et soit ce qu’elle est, et que la fenêtre de sa chambre donne précisément sur le chemin où se trouve le caillou) ; pour le faire, il faudrait refaire tout l’historique de la construction de cette maison et tout l’historique patrimonial et éducationnel de la famille d’Émilie... Sans parler des ressorts historiques et psychologiques de la relation entre Jean et Émilie.
La conclusion vient d’elle-même : affirmer que la « cause » du bris de vitre est le jet du caillou réduit le phénomène à une chaîne causale linéaire et rudimentaire, alors que sa réalité est infiniment plus complexe et convoque la totalité de tous les processus en œuvre dans l’univers depuis la nuit des temps. Il aurait suffi qu’un seul élément manquât dans le plus lointain passé pour que le phénomène du bris de cette vitre ne se passât point.
Si l’on veut être conséquent, il faut éliminer de notre mode de penser le principe de causalité linéaire et ana- lytique, et le remplacer par un principe de convergence intégrale et holistique.
Si l’on pose que tout dans l’univers est déterminé par des relations « dures » de causalité, le libre arbitre est un leurre : il devient une simple preuve de l’ignorance où l’homme est, des déterminations qui s’imposent à lui, inconsciemment, venant tant du dehors que du dedans.
Personne à ma connaissance, et surtout ni Spinoza ni Leibniz, n’a jamais soutenu une telle énormité. Une preuve parmi mille autres en est que Spinoza formule l’hypothèse que semblent minimiser d’aucuns, du conatus, propre à chaque être et exprimant l’ensemble des potentialités qu’il porte en lui et dont la réalisation le mènera à la joie et à la perfection.
Avant d’aller plus loin, une remarque s’impose : l’univers est guidé par un ensemble de « lois » qui pilotent son évolution globale ainsi que les évolutions spécifiques de chacune de ses parcelles. Ces lois ne sont ni morales ni immorales. Elles sont amorales. Pour reprendre un mot d’Albert Einstein dans son Comment je vois le monde : « La morale n’a rien de divin, c’est une question purement humaine. » Le Mal, c’est ce qui fait du mal à l’homme ; le Bien c’est ce qui lui fait du bien. Rien de plus, rien de moins. Il n’y a pas d’impératifs catégoriques transcendantaux : Kant a tort. Toute morale est conventionnelle : des valeurs édictées par les pouvoirs en place pour conforter ce pouvoir. La morale est un instrument politique et rien d’autre. Nietzsche l’a parfaitement démontré.
Venons-en maintenant à l’essentiel, et posons quelques définitions avant d’en découdre avec le causalisme et le déterminisme.
J’appelle « système » toute portion identifiable et organisée de l’univers, possédant des attributs qui lui sont propres (une idiosyncrasie, donc). Tout objet (de l’atome à la galaxie), tout être (de l’amibe à l’homme) sont des systèmes. Leibniz utilisait le mot « monade » pour désigner la même chose. On constate que les systèmes entretiennent entre eux des relations diverses comme des interactions (A attire B) ou des structurations (A contient B), etc.
J’appelle « intention » la force immanente qui pousse tout ce qui existe à s’accomplir en plénitude ou, plus précisément, qui pousse tout ce qui existe à accomplir tout l’accomplissable en soi et autour de soi. Cette notion d’intention recouvre celles d’entéléchie chez Aristote, de conatus chez Spinoza et de volonté de puissance chez Nietzsche. Tout système est le lieu de confrontation d’une intention globale de l’univers dans lequel il est plongé (l’intention du « dehors ») et d’une intention spécifique qui lui est propre (l’intention du « dedans » qui est, à la fois, idiosyncratique et phylétique). Par leur nature, ces deux intentions sont identiques (accomplir tout l’accomplissable), mais leurs modalités sont différentes, voire antagoniques. Par exemple, l’accomplissement de la biosphère exige un réchauffement climatique nul, mais l’accomplissement humain exige des transformations énergétiques qui rejettent des calories dans l’atmosphère.
J’appelle « champ d’évolution » l’ensemble des scénarii d’évolution qui ressortent de la confrontation entre l’intention globale (celle du « dehors » du système) et l’intention spécifique (celle du « dedans » du système). Plus ce système sera rudimentaire (non complexe, mécanique), plus le nombre de ces scénarii d’évolution se réduira à un seul. On pourra parler, alors, de déterminisme strict, comme pour les trajectoires mécaniques des boules de billards sur un tapis vert.
J’appelle un « possible », un scénario d’évolution compatible, à la fois, avec l’intention interne (la vocation propre du système) et l’intention externe (les contraintes imposées par le monde tel qu’il est et tel qu’il va).
J’appelle un « impossible », un scénario d’évolution qui, pour être mis en œuvre, demanderait, au système, la mobilisation d’une quantité d’énergie dont il ne dispose pas. L’ensemble des impossibles constitue le champ de contrainte propre au système étudié.
On peut parler de causalisme dès lors qu’il existe des impossibles qui restreignent le nombre des possibles offerts au système à un moment donné.
On peut parler de déterminisme strict dès lors qu’à tout moment, le champ des possibles se réduit à un seul.
On peut parler d’indéterminisme relatif dès lors que le champ des possibles est multiple et que tous ces possibles sont équiprobables.
On en vient alors au fond du problème tel que Spi- noza, Leibniz et Nietzsche le posent.
Primo : le champ des contraintes, c’est-à-dire des impossibles, est une donnée ; il résulte du monde tel qu’il est et tel qu’il va, c’est-à-dire de tous les arbitrages d’optimisation qui ont été réalisés depuis la naissance de l’univers ; il traduit bien l’idée du « meilleur des mondes possibles » chère à Leibniz et à Spinoza. Il ne s’agit pas là d’un jugement de qualité ou de morale, il s’agit seulement d’observer que l’évolution cosmique est un processus global d’optimisation qui vise, dialectiquement, la plénitude des accomplissements spécifiques et globaux.
Marc Halévy
Si cet extrait vous a intéressé,
vous pouvez en lire plus
en cliquant sur l'icone ci-dessous