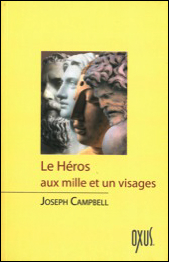Le mythe et le rêve : une source vive d’inspiration

Silènes et Ménades
(amphore hellène à figures noires, Sicile, vers 500-450 av. J.-C.)
Que nous écoutions avec une réserve amusée les incantations obscures de quelque sorcier congolais aux yeux injectés de sang, ou que nous lisions, avec le ravissement d’un lettré, de subtiles traductions des sonnets mystiques de Lao-tseu ; qu’il nous arrive, à l’occasion, de briser la dure coquille d’un raisonnement de saint Thomas d’Aquin ou que nous saisissions soudain le sens lumineux d’un bizarre conte de fées esquimau – sous des formes multiples, nous découvrirons toujours la même histoire merveilleusement constante. Partout, la même allusion l’accompagne avec une persistance provocante : allusion à l’expérience qui reste à vivre, plus vaste qu’on ne le saura ou qu’on ne le dira jamais.
D’un bout à l’autre du monde habité et de tout temps toutes les circonstances de la vie de l’homme ont été prétexte à la floraison des mythes et ce sont eux qui ont été la source vive d’inspiration de tout ce que l’esprit humain a pu produire. Il ne serait pas exagéré de dire que le mythe est l’ouverture secrète par laquelle les énergies inépuisables du cosmos se déversent dans les entreprises créatrices de l’homme. Les religions, les philosophies, les arts, les formes sociales de l’homme primitif et historique, les principales découvertes de la science et de la technologie, les rêves mêmes qui troublent le sommeil proviennent du cercle magique et fondamental du mythe.
L’étonnant est que le moindre conte de nourrice soit doué de ce pouvoir caractéristique de toucher et d’inspirer les centres créateurs profonds ; de la même manière, la moindre goutte d’eau a la saveur de l’océan et l’œuf de la puce contient tout le mystère de la vie. Car les symboles de la mythologie ne sont pas fabriqués ; l’homme n’en est pas maître. Il ne peut ni les inventer ni les supprimer définitivement. Ce sont des produits spontanés de la psyché et chacun d’eux renferme le pouvoir de germination de la source dont il provient. Quel est le secret de ces images éternelles ? À quelle profondeur de l’esprit se situent-elles ? Pourquoi, sous la diversité du costume, la mythologie est-elle partout la même ? Et quel est son enseignement ?
Nombreuses sont aujourd’hui les sciences qui cherchent à analyser cette énigme. Des archéologues fouillent les ruines de l’Irak, du Ho-nan, de la Crète et du Yucatán. Des ethnologues interrogent les Ostiaks du fleuve Ob, les Boobies de l’île de Fernando Po. Toute une génération d’orientalistes nous a récemment fait découvrir les textes sacrés de l’Orient et donné accès aux sources pré-hébraïques de l’Écriture sainte. Dans le même temps, des équipes de savants, poursuivant sans relâche les recherches entreprises au siècle précédent dans le domaine de la psychologie des peuples, s’efforçaient d’établir les bases psychologiques du langage, du mythe, de la religion, des arts et des éthiques.
Les révélations les plus surprenantes, cependant, sont celles fournies par les hôpitaux psychiatriques. Les écrits audacieux des psychanalystes, dont les découvertes ont véritablement marqué notre époque, sont indispensables pour qui étudie la mythologie ; car, quoi qu’on puisse penser des interprétations de détail, parfois contradictoires, des cas particuliers et des problèmes d’espèce, Freud, Jung et leurs disciples ont démontré irréfutablement que la logique du mythe, ses héros et leurs exploits survivent de nos jours. En l’absence d’une mythologie collective efficace, chacun de nous possède son propre panthéon onirique, insoupçonné, rudimentaire et cependant secrètement agissant. La dernière incarnation d’Œdipe, les héros ressuscités du roman de la Belle et la Bête attendent, cet après-midi, au coin de la 42e Rue et de la 5e Avenue, que le feu rouge passe au vert.
J’ai rêvé (écrivit un jeune Américain au rédacteur d’une chronique publiée par une chaîne de journaux) que je réparais la toiture de notre maison. Soudain, j’entendis la voix de mon père qui, resté à terre, m’appelait d’en bas. Je me retournai vivement pour mieux l’entendre et, dans le mouvement que je fis, le marteau m’échappa des mains, glissa sur la pente du toit et disparut par-dessus bord. J’entendis un bruit sourd, comme un corps qui tombe. Affolé, je descendis l’échelle et trouvai mon père étendu à terre, mort, la tête baignant dans le sang. J’en ressentis une profonde douleur et, tout en sanglotant, je me mis à appeler ma mère. Elle sortit de la maison et me prit dans ses bras : « Ne t’en fais pas, mon fils ! C’est un accident, me dit-elle. Je sais bien que tu t’occuperas de moi, même s’il n’est plus là. » Elle m’embrassa et je me réveillai.
Je suis l’aîné de la famille et j’ai vingt-trois ans. Je me suis séparé de ma femme il y a un an ; d’ailleurs nous ne pouvions plus nous entendre. Je suis très attaché à mes parents et je n’ai jamais eu la moindre difficulté avec mon père, sauf lorsqu’il insistait pour que je retourne vivre avec ma femme ; mais je ne pourrais pas être heureux avec elle. Je n’y consentirai donc jamais1.
Le mari malheureux révèle ici, avec une candeur véritablement merveilleuse, qu’au lieu de reporter ses énergies spirituelles sur l’amour et les problèmes de son mariage, il s’est attardé dans les replis secrets de son imagination, à la situation dramatique, devenue ridiculement anachronique, de son premier et unique conflit émotionnel : celui du triangle tragicomique de la petite enfance : rivalité du fils avec son père pour obtenir l’amour de la mère. Il semble que les tendances les plus constantes de la psyché humaine soient celles qui découlent du fait que, parmi tous les animaux, nous soyons ceux qui restent le plus longtemps attachés à la mamelle. Les hommes naissent trop tôt ; ils sont inachevés, incapables encore d’affronter le monde. En conséquence, leur seule défense face à un univers de dangers est la mère, sous la protection de laquelle ils prolongent la période intra-utérine2. De là vient que l’enfant et la mère dont il dépend forment une unité duelle pendant les mois qui suivent la catastrophe de la naissance et cela, tant sur le plan psychologique que sur le plan physiologique3. Toute absence prolongée de la mère provoque des tensions chez le nourrisson et, en conséquence, des pulsions agressives ; des réactions d’agressivité apparaissent également lorsque la mère est obligée de s’opposer à l’enfant. De sorte que l’objet premier de l’hostilité de l’enfant est le même que le premier objet de son amour, et que son premier idéal (conservé par la suite comme fondement inconscient de toutes les images de bonheur, de vérité, de beauté et de perfection) est cette unité duelle que symbolisent les « Vierges à l’Enfant »4.
Le malheureux père représente, lui, la première intrusion fondamentale d’un autre ordre de réalité dans la félicité parfaite vécue dans le sein maternel et rétablie sur terre. Il est donc ressenti essentiellement comme un ennemi. C’est sur lui que se reporte la charge d’agression réservée, à l’origine, à la « mauvaise » mère, c’est-à-dire à la mère absente, tandis qu’elle reste (en général) l’objet du désir réservé à la « bonne » mère, c’est-à-dire à la mère présente, nourricière, protectrice. Cette répartition fatale chez l’enfant de l’instinct de mort (thanatos : destrudo) et de l’instinct d’amour (éros : libido) est à la base du complexe d’Œdipe, bien connu maintenant et dans lequel Sigmund Freud a vu, il y a près d’un demi-siècle, la cause majeure de notre incapacité à nous comporter comme des êtres raisonnables, une fois atteint l’âge adulte. Comme il l’a défini lui-même : « Œdipe, qui tue son père et épouse sa mère, ne fait qu’accomplir un des désirs de notre enfance. Mais, plus heureux que lui, nous avons pu, depuis lors, dans la mesure où nous ne sommes pas devenus névropathes, détacher de notre mère nos désirs sexuels et oublier notre jalousie contre notre père. »5* Ou, comme il l’écrit encore : « Tous les troubles morbides de la vie sexuelle peuvent, à bon droit, être considérés comme résultant d’inhibitions dans le cours du développement. »6
Car plus d’un homme a partagé en songe
Le lit de sa mère ! Mais celui qui sait surmonter De telles frayeurs supporte un destin plus facile7 !
L’apparente absurdité du rêve suivant nous permettra de mesurer dans quelle fâcheuse situation se trouve l’épouse d’un homme dont les sentiments, au lieu de parvenir à maturité, sont restés fixés au stade de la petite enfance et des contes bleus ; nous commençons ici à vraiment sentir que nous pénétrons, mais par un biais singulier, dans l’antique royaume du mythe.
J’ai rêvé, écrivit une femme, qu’un grand cheval blanc me suivait partout où j’allais. Il me faisait peur et je le poussai pour qu’il s’éloigne de moi. Je me retournai pour voir s’il continuait à me suivre et je m’aperçus qu’il était devenu un homme. Je lui dis d’aller chez le coiffeur faire couper sa crinière. Ce qu’il fit. Quand il en ressortit, il ressemblait tout à fait à un homme, sauf qu’il avait des sabots et une tête de cheval et qu’il continuait à me suivre partout où j’allais. Il s’approcha plus près de moi et je me réveillai.
Je suis mariée, j’ai trente-cinq ans, deux enfants ; il y a quatorze ans que je suis mariée et je suis certaine que mon mari m’est fidèle8.
L’inconscient suscite dans l’imagination toutes sortes de fantômes, d’êtres étranges, de terreurs et d’images trompeuses – que ce soit en rêve, dans la vie diurne ou en cas de démence. Car sous le sol de la petite maison relativement ordonnée dans laquelle nous vivons et que nous appelons notre conscience, le royaume de l’homme s’enfonce dans les cavernes inconnues d’Aladin ; tout n’y est pas que pierres précieuses ; des djinns dangereux y demeurent aussi : forces psychologiques importunes ou refoulées auxquelles nous ne pensons pas ou que nous n’avons pas osé intégrer à notre vie. Nous pouvons continuer à les ignorer, mais il peut arriver, au contraire, qu’une parole inattendue, une odeur de campagne, la saveur d’une tasse de thé ou l’éclair d’un regard déclenchent un ressort magique et provoquent, dans notre cerveau, l’apparition des dangereux messagers. Ils sont dangereux parce qu’ils menacent l’édifice de sécurité à l’intérieur duquel nous nous sommes retranchés, nous et notre famille. Mais ils exercent aussi un charme ensorcelant, car ils sont porteurs des clefs qui ouvrent tout le royaume de l’aventure, désirée et redoutée tout ensemble, de la découverte de soi. Destruction du monde que nous avons construit et dans lequel nous vivons, et de nous dans ce monde ; mais ensuite reconstruction merveilleuse d’une vie plus audacieuse, plus pure, plus vaste et pleinement humaine : tels sont l’attrait, l’espoir et l’effroi que suscitent ces inquiétants visiteurs nocturnes, venus du royaume mythologique que nous portons en nous.
La psychanalyse, cette science moderne des rêves, nous a appris à être attentifs à des images immatérielles. Elle a également découvert comment les laisser agir. Les dangereuses crises de croissance du moi peuvent ainsi se dérouler sous l’œil protecteur d’un initié qui connaît le langage des rêves et assume donc le rôle et la qualité de l’ancien mystagogue, ou guide des âmes, du guérisseur des sanctuaires primitifs de la forêt qui présidait aux épreuves et à l’initiation. Le médecin est le maître actuel du royaume mythologique, il est celui qui sait tous les secrets, qui connaît toutes les formules magiques. Son rôle est précisément celui du Sage Vieillard des mythes et des contes de fées qui, de ses conseils, aide le héros à surmonter les épreuves et les terreurs qui jalonnent l’aventure mystérieuse. C’est lui qui apparaît et montre du doigt l’épée magique fulgurante qui terrassera le dragon-terreur ; c’est lui qui parle de la fiancée lointaine et du château aux trésors, qui applique un baume salutaire sur les blessures dont le héros allait mourir et qui, finalement, le renvoie, vainqueur, au monde de la vie quotidienne, après sa grande aventure dans la nuit enchantée.
Si,gardant cette image à l’esprit,nous entreprenons maintenant d’examiner les nombreux et étranges rituels des tribus primitives et des grandes civilisations du passé, il devient manifeste que leur but et leur action réels étaient d’aider les hommes à franchir ces seuils de transformation, ces seuils difficiles qui requièrent un changement des structures non seulement de la vie consciente, mais aussi de la vie inconsciente. Les rites dits de passage, qui tiennent une place si importante dans la vie des sociétés primitives (rituels de la naissance, de l’attribution du nom, de la puberté, du mariage, des funérailles, etc.), se caractérisent par des pratiques solennelles de séparation, généralement très pénibles, par lesquelles l’esprit rompt radicalement avec les attitudes, les attachements et les formes de vie correspondant au stade de développement qu’il s’agit de dépasser*. Ensuite vient un temps plus ou moins long de retraite, pendant lequel sont accomplis des rites destinés à faire connaître à l’« aventurier de la vie » les formes et les sentiments qui conviennent à son nouvel état ; de sorte que, lorsque le moment viendra pour lui de réintégrer son monde habituel, l’initié sera pratiquement né de nouveau9.
Le plus stupéfiant, du reste, est le fait qu’un grand nombre d’épreuves et d’images rituelles correspondent à celles qui apparaissent spontanément dans les rêves du psychanalysé lorsque, abandonnant ses fixations infantiles, il commence à s’ouvrir à l’avenir. Chez les aborigènes d’Australie, par exemple, l’un des moments capitaux de l’épreuve initiatique (qui consiste, à la puberté, à soustraire l’enfant à sa mère et à l’introduire dans la société des hommes pour qu’il soit initié à leur science secrète) est le rite de la circoncision.
Quand un jeune garçon de la tribu des Murngins doit être circoncis, ses pères et les anciens lui disent : “L’Ancêtre Serpent flaire ton prépuce ; il le réclame.” Les enfants le croient à la lettre et sont épouvantés. Ils se réfugient habituellement auprès de leur mère, de la mère de leur mère ou de quelque autre parente bien-aimée, car ils savent que les hommes vont s’employer à les entraîner dans le territoire des hommes où mugit le grand serpent. Les femmes se lamentent rituellement sur les enfants : c’est pour empêcher que le grand serpent ne les avale10.
Voyons maintenant la version donnée par l’inconscient. « Dans un rêve, écrit le Dr C.G. Jung, un malade a rencontré l’image suivante : “Un serpent surgissait tout à coup d’une cave humide et mordait le rêveur dans la région génitale”. Ce rêve se produisit au moment où le malade fut convaincu de la vérité de l’analyse et où il commença à se libérer de son complexe maternel. »11 La fonction principale de la mythologie et du rite a toujours été de fournir à l’esprit humain les symboles qui lui permettent d’aller de l’avant et l’aident à faire face à ces fantasmes qui le freinent sans cesse. Il est bien possible, en effet, que la grande fréquence des névroses que nous constatons autour de nous soit due à la carence d’une aide spirituelle efficace de cet ordre. Nous restons fixés aux images non exorcisées de notre petite enfance et peu disposés, de ce fait, à franchir les seuils indispensables pour parvenir à l’âge adulte. Aux États-Unis, les valeurs ont même été inversées : le but n’est pas d’atteindre l’âge mûr mais de rester jeune, non pas de devenir adulte en se détachant de la Mère, mais de lui rester attaché. Aussi, pendant que les maris se prosternent devant les autels de leur jeunesse, tout en étant les avocats, les commerçants ou les esprits supérieurs que leurs parents souhaitaient qu’ils devinssent, leurs épouses, même après quatorze ans de mariage et bien qu’elles aient mis au monde et élevé deux beaux enfants, sont toujours à la recherche de l’amour. Et encore ne peut-il venir à elles que sous forme de centaures, silènes, satyres et autres incubes concupiscents de la troupe de Pan qu’elles retrouvent en songe comme c’est le cas dans le rêve cité plus haut, ou sous le maquillage des derniers héros de l’écran, dans les temples de carton-pâte dédiés au culte de Vénus. Pour finir, il faut que vienne le psychanalyste qui réaffirmera la sagesse éprouvée des anciens enseignements prospectifs que dispensaient les danseurs masqués exorciseurs et les sorciers-guérisseurs-circonciseurs. Et nous découvrons alors, comme dans le rêve de la morsure de serpent, que l’éternel symbolisme initiatique est créé spontanément par le patient lui-même au moment où il se libère. Apparemment, ces images initiatiques contiennent quelque chose de si nécessaire à la psyché que si le monde extérieur ne les apporte pas par l’entremise du mythe et du rituel, il faut qu’elles soient retrouvées au travers du rêve, de l’intérieur – faute de quoi nos énergies resteraient enfermées dans une
banale et anachronique chambre d’enfant, au profond de la mer.
Dans ses ouvrages, Sigmund Freud fait ressortir les passages et les difficultés qui appartiennent à la première moitié du cycle de la vie humaine : celles de l’enfance et de l’adolescence, qui représentent l’ascension de notre soleil vers son zénith. En revanche, C.G. Jung insiste sur les crises de la seconde moitié de la vie, celles qui correspondent à ce moment où le disque solaire, pour progresser, doit accepter de descendre et, finalement, de disparaître dans la ténébreuse matrice de la tombe. Au soir de la vie, les symboles ordinaires de nos désirs et de nos peurs se changent en leurs contraires ; car ce n’est plus la vie mais la mort qui nous défie. Ce n’est plus le sein maternel, mais le phallus, qu’il est alors difficile d’abandonner – à moins qu’une lassitude de la vie n’ait déjà gagné notre cœur lorsque retentira l’appel de la mort, avec, pour nous séduire, la promesse d’une félicité qui, autrefois, nous fascinait dans l’amour. Le cercle se referme : de la tombe qu’est le sein maternel au sein maternel qu’est la tombe, nous allons – incursion ambiguë, énigmatique, dans un monde de matière à l’état solide qui ne tardera pas à s’évanouir, comme la substance d’un rêve. Et si nous jetons un regard en arrière sur ce qui promettait d’être notre aventure personnelle, unique, imprévisible et dangereuse, nous ne découvrons, en définitive, qu’une succession de métamorphoses classiques, comme en ont subi tous les hommes et toutes les femmes, dans toutes les parties du monde, à toutes les époques et sous tous les étranges travestissements des civilisations.
L’histoire du roi Minos, par exemple, raconte comment ce grand souverain de l’empire crétois, alors au sommet de sa suprématie commerciale, s’assura les services de Dédale et comment le célèbre architecte conçut et construisit pour lui un labyrinthe où cacher cette chose dont le palais avait à la fois honte et peur. Dans ses murs, en effet, il y avait un monstre enfanté par la reine Pasiphaé. Tandis que le roi Minos était, dit-on, occupé à des guerres importantes pour protéger les routes commerciales de son royaume, Pasiphaé avait été séduite par un magnifique taureau, blanc comme neige et né de la mer. Ce qui n’était pas pire, à vrai dire, que ce à quoi s’était prêtée la propre mère de Minos, Europe ; on sait, en effet, qu’elle avait été ravie par un taureau qui l’avait emportée en Crète. Ce taureau-là était Zeus et le fils vénéré de cette union sacrée, Minos lui-même, maintenant partout respecté et servi sans réserve. Comment donc Pasiphaé aurait-elle pu se douter que le fruit de son imprudence à elle serait un monstre : ce petit enfant à corps d’homme mais à tête et à queue de taureau ?
Son entourage blâma beaucoup la reine ; mais le roi n’était pas sans avoir conscience de la part qui lui revenait dans la faute. Le taureau en question avait été envoyé par Poséidon, longtemps auparavant, lorsque Minos disputait le trône à ses frères. Minos, prétendant que le trône lui revenait de droit divin, avait prié le dieu de faire sortir de la mer un taureau en témoignage ; pour sceller sa prière, il avait fait vœu de sacrifier aussitôt l’animal, en symbole de soumission. Le taureau apparut et Minos monta sur le trône ; mais, ayant contemplé la majesté de la bête que Poséidon lui avait envoyée et réfléchi aux avantages qu’il y aurait à posséder un tel animal, il décida d’user d’une ruse de trafiquant dont il supposait que le dieu ne se formaliserait guère. Il sacrifia sur l’autel de Poséidon le plus beau taureau blanc qu’il possédât et adjoignit l’autre à son troupeau.
L’empire crétois avait beaucoup prospéré sous le gouvernement avisé de ce célèbre législateur, modèle d’attachement au bien public. Cnossos, la capitale, était devenue le centre élégant et luxueux d’une des premières puissances commerciales du monde civilisé. La céramique crétoise était appréciée en Babylonie et en Égypte, et la flotte naviguait vers toutes les îles et tous les ports de la Méditerranée. Intrépides, leurs frêles embarcations franchissaient les Colonnes d’Hercule pour gagner le vaste océan et, de là, longeaient les côtes, tant vers le nord pour rapporter l’or d’Irlande et l’étain de Cornouailles12, que vers le sud où, contournant le Sénégal, elles atteignaient le lointain pays des Yorubas et les centres reculés du commerce de l’ivoire, de l’or et des esclaves13.
Mais, en son royaume, la reine, sous l’inspiration de Poséidon, avait conçu une passion irrésistible pour le taureau. Elle avait convaincu l’habile architecte de son mari, l’incomparable Dédale, de fabriquer pour elle une vache en bois qui puisse abuser le taureau. Fiévreusement elle y pénétra ; et le taureau se méprit.
----------------
<?> On a observé que le père, lui aussi, peut être ressenti comme protecteur et, partant, la mère comme ten- tatrice. C’est par là qu’Œdipe rejoint Hamlet. « Ô Dieu ! Je pourrais être confiné dans une coque de noix et me compter roi des espaces infinis, si ce n’était que j’ai de mauvais rêves. » (Hamlet, II, iv)
« Tous les névrosés, écrit le Dr Freud, sont soit Œdipe, soit Hamlet. »
Lorsqu’il s’agit non plus d’un fils mais d’une fille, le problème se complique légèrement : ce qui suit l’éclairera suffisamment, étant donné la brièveté avec laquelle le sujet est exposé ici. « J’ai rêvé la nuit dernière que mon père poignardait ma mère en plein cœur. Elle en mourait. Je savais que personne ne blâmait mon père de ce qu’il avait fait ; pourtant je pleurais amèrement. Il me parut que le rêve changeait et que nous partions ensemble en voyage. Je me sentais très heureuse. » C’est le rêve d’une jeune femme célibataire de vingt-quatre ans. (Wood, op. cit., p. 130).
* Dans les cérémonials tels que ceux de naissance et de mort, les effets significatifs sont, bien entendu, ceux que ressentent les parents et les membres de la famille. Les rites de passage ont tous pour but de toucher non seulement le candidat, mais également chacun des membres de son entourage.
Joseph Campbell
Si cet extrait vous a intéressé,
vous pouvez en lire plus
en cliquant sur l'icone ci-dessous