
Les grands maîtres de l'architecture et la géobiologie
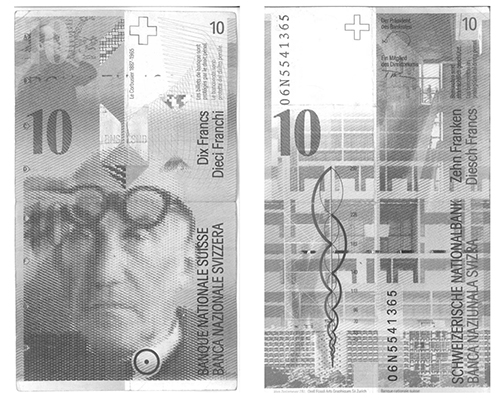 Le Corbusier en banquier suisse © Dangles
Le Corbusier en banquier suisse © Dangles
La trace prémonitoire de cette nouvelle discipline, la géobiologie, reposait, dans la pensée des quatre architectes dont nous allons parler et dans la mienne propre (à l’aube de mon exercice professionnel), sur l’intuition selon laquelle les ondes naturelles, reliant Terre et cosmos, ont un impact sur le vivant. L’objet de cette étude est de démontrer la pertinence de cette intuition, alors qu’on modifie les effets de cet impact environnemental naturel, lorsqu’on construit : l’architecture modifie le trajet de ces ondes. Par voie de conséquence, elle modifie leur impact sur le vivant, donc sur le comportement des personnes, leur bien-être, leur mental et leur santé.
On se doutait de l’effet de l’architecture sur les personnes, nous allons essayer d’en décrypter les mécanismes vibratoires, annoncés chez quatre architectes reconnus au xxe siècle pour leur œuvre magistrale.
Frank LloyD Wright
Trente secondes suffirent à mon initiation d’étudiant boutonneux, le 4 octobre 1959, le temps de peser sur le pêne et le battant de la porte de mon futur et tout nouvel atelier, l’Atelier Faugeron, rue J. Callot, Paris Ve.
La première personne que je rencontrai fut Frank Lloyd Wright, qui en sortait. Que les exégètes de cette figure historique et emblématique vérifient leurs textes : FLW lui-même parcourait l’Europe quelques jours avant sa disparition du monde des vivants. Soyons clair, ce face-à-face historique n’a laissé sa trace que dans ma mémoire émue. Ce monstre sacré, reconnu par ses pairs et le monde entier, était le représentant le plus fin, le plus distingué, le plus visionnaire de notre profession contemporaine jusque dans ses extrêmes les plus autoritaires et les plus contestables. N’a-t-il pas dessiné avant de disparaître, en 1959, le one-mile-high skyscraper ? Ses paroles qui scellèrent mon destin furent à la hauteur de mon insignifiance statutaire puisqu’il ne m’en est resté qu’un souvenir vague, en réponse à mon bredouillement devant sa personne bien mise – FLW portait beau. De taille modeste mais fine, il émanait de sa personne raffinée comme un parfum de rose. Ayant refermé à l’instant une cape de laine bistre et s’étant coiffé de son grand chapeau de fil beige, il équilibrait son passage sur le seuil de l’Atelier d’un coup de canne à pommeau d’argent et réussissait ainsi sa sortie de notre institution vénérable, l’École nationale supérieure des Beaux-Arts section architecture, en sa qualité de grand commandeur de l’art architectural du xxe siècle alors même que, moussaillon, j’y entrais.
FLW, dont il me fut donné une manière de bénédiction fugitive sur le seuil de l’Atelier Faugeron, reste pour ma génération l’architecte le plus visionnaire et le plus déterminant du siècle passé. N’a-t-il pas stoppé dans sa longue carrière américaine le ridicule et plastronnant plagiat gréco-romain des édifices publics ou privés, en tout cas institutionnels, en recherche d’une caution sociale, esclaves serviles et entêtés du pouvoir de l’argent et des honneurs ? Engageant cette lutte historique avec l’ordre établi, lutte au demeurant sans doute inconsciente, il proposait ce qu’il a appelé élégamment « l’architecture organique »1, première pierre d’un édifice dialectique que nous appellerions aujourd’hui le « développement durable », façon HQE (haute qualité environnementale).
Qu’est-ce que l’architecture « organique », au sens wrightien du terme ? Reprenons son discours pour illustrer notre propos, par une autre question qu’il se pose, dès les premières pages de son livre :
"Le changement est le seul élément immuable du paysage".
Mais les changements disent ou chantent tous à l’unisson la loi cosmique. [...] Ces lois cosmiques, autant qu’elles sont des lois du paysage, sont des lois physiques qui régissent toutes les constructions humaines. »
« Quel est ce royaume intérieur du rythme qui danse dans les êtres et repose dans les structures ? »
Mais il limite sa pensée à la question suivante :
« Quel rôle joue alors cette créature singulière qu’est l’homme ? Lui qui s’assure la prédominance sur toutes choses, que fera-t-il pour la conserver ? Quelle doit être son attitude essentielle ? Ce maître vulnérable des causes et des effets, que sait-il des lois cosmiques ? »
Il en restera, hélas, à l’énoncé de cette question, à laquelle nous essayons aujourd’hui, ici, de répondre.
Il abordera cependant avec précision la prédominance de la voûte comme fondement de la forme architecturale :
« Peut-être l’architecture persane a-t-elle été l’ultime et la plus parfaite réalisation de cette qualité de l’esprit qu’est le sens de l’abstrait en tant que forme, tel qu’il se développe en architecture. Ce sens s’est lentement perdu et peut-être ne sera-t-il jamais retrouvé, à moins que, dans les années à venir, une architecture organique ne trouve sa forme idéale, à la fois logique et passionnée. Pour rappeler cette haute phase de l’architecture humaine qui est celle de la Perse, ces masses simples et d’esprit noble demeurent, avec le réseau exquis de leur sensibilité. Il faut compter le dôme naturel comme un des toits les plus consciemment construits du monde de l’architecture. »
« En architecture, comme dans la vie, séparer l’esprit de la matière détruit l’un et l’autre. »
Nous sommes donc ici, nous architectes, depuis Wright, placés devant nos responsabilités.
Nous sommes dorénavant assujettis à introduire dans nos travaux ce supplément d’âme qui réside dans ces lois qui nous dépassent et qui pourtant n’ont jamais été aussi proches de nous, grâce aux progrès fantastiques qu’ont réalisés les recherches récentes sur ces fameuses lois cosmiques, cette astronomie dans laquelle nous baignons depuis toujours et que nous n’expliquons scientifiquement que depuis quelques années.
Wright annonce ici (sans l’expliquer) une révolution dans l’art de l’architecture qui change notre rapport au monde. Cet art de nous relier à la Terre et au cosmos dont il parle est en nous. Il nous tient pour la première fois éloignés des modes et des effets de manche des magazines spécialisés de l’architecture. Depuis les « Taliesin », ses bureaux en plein désert, et la « Maison sur la cascade », son œuvre domestique la plus célébrée, l’architecture organique est en marche.
Mais, en fait, qu’en est-il humainement, de « l’Architecture organique », au-delà des rapports au cosmos ? Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
À ces questions, il faut tout d’abord répondre par l’environnement. Voici une autre définition que donne FLW, en 1957, dans son « Testament » (paru aux éditions Parenthèses) :
« L’environnement et la construction ne font qu’un. Le site, les plantations, la structure, l’ameublement, la décoration sont indissociables dans l’architecture organique. Voilà ce que la postérité appellera “l’architecture moderne”. »
Prémonitoire, is it not ?
Ensuite, il y a le sens. En effet, comment qualifier cette approche si particulière de l’architecture de FLW, constante d’une construction à l’autre : toits majestueux et largement débordants, façades massives, horizontalité des profils, abri sanctuarisé de l’habitat ?
« L’architecture organique ne voit pas l’abri seulement comme une qualité de l’espace, mais aussi comme une qualité de l’esprit et comme le facteur primordial de l’insertion de l’homme dans son environnement, dont il devient partie intégrante. »
Ainsi, FLW développe son sujet sur la notion d’abri, sensible aux éléments climatiques : ombre, clarté, pluie, froid, chaleur..., mais pas seulement. Il y a aussi la lumière intérieure :
« La Lumière de l’Homme est au-dessus de l’instinct. [...] L’imagination humaine naît de cette lumière intérieure, elle conçoit, elle crée. [...]L’esprit de l’homme s’en trouve éclairé et dans la mesure où sa vie est cette lumière qui émane de lui, celle-ci illumine à son tour son espèce. [...] Il n’est rien de plus élevé dans la conscience humaine que les rayons de cette lumière intérieure. On les appelle la beauté [...] dont la source se trouve dans l’âme. [...] Nous pouvons alors appeler humanité la lumière qui ne s’éteint jamais. »
Du cosmos à la lumière intérieure de l’homme, donc. Nous y reviendrons.
Le Corbusier
« Corbu » nous introduit dans le monde parallèle de la mesure de l’homme en rapport avec l’univers. « La quatrième dimension », dit-il.
Sur les bases historiques et universelles de la coudée, du pan, de la foulée, il élabore un système de mesures d’usage simple : l’homme assis (43 cm), attablé (70 cm), appuyé (86 cm), accoudé (1,13 m), debout (1,83 m), le bras levé (2,26 m). Ce sont des mesures basées sur la série des nombres du mathématicien Fibonacci, intimement liées entre elles par le rapport de leur doublement et à l’homme par l’hypothèse d’un personnage fictif de 1,83 m de hauteur, vivant sous notre latitude. Ces mesures que Corbu qualifie également d’universelles sont en effet plus plausibles que l’arbitraire mètre de cent centimètres issu de la Révolution française.
Ce mètre entend aujourd’hui tout régenter de façon rationnelle et donc abstraite. De même, le système « pied-pouce » anglo-saxon, dont la justification moderne ne repose plus que sur des habitudes industrielles et des convenances linguistiques, n’offre aujourd’hui comme seul véritable avantage par rapport au système métrique que de pouvoir communiquer dans les pays de langue et de tradition anglaises.
« Le mètre, indifférent à la taille des hommes et se divisant en autant de mesures indifférentes à la stature humaine puisqu’il n’existe aucun homme d’un mètre ou de deux mètres, [...] semble avoir introduit des mesures étrangères qui, si l’on y regarde de près, pourraient bien être accusées d’avoir disloqué l’architecture, de l’avoir pervertie. » (Le Corbusier, Le Modulor, Éd. l’Architecture d’aujourd’hui, Coll. « Ascoral », 1958)
Albert Einstein, consulté en mai 1946 à Princeton sur la conception du Modulor par Corbu, adopte une attitude amicale et positive :
« C’est une gamme des proportions qui rend le mal difficile et le bien facile. »
Comme dit Corbu en réponse à cette appréciation extraordinaire :
« Cette arme tire juste, elle rend le bien facile et la tâche plus assurée. »
Et FLW confirme :
« Ce critère inéluctable de l’architecture organique implique un sens des proportions entièrement nouveau. La taille humaine m’est apparue, vers 1893 ou avant, comme la véritable échelle humaine de l’architecture. »
Jean faugeron
Pour étayer le chapitre de ma traversée météorique de l’École des Beaux-Arts, section architecture, je veux rendre hommage à ce grand patron de l’École que fut Jean Faugeron, à son talent de créateur et à la sensibilité du rythme architectural qu’il nous a communiquée, dans le silence de ces séances de dessin partagé sur les carnets de croquis qu’il nous obligeait à remplir et dans ses injonctions à faire l’école buissonnière.
Jean Faugeron, architecte d’allure et de comportement de sénateur romain doté d’une magnifique patte d’artiste, s’autorisait à asséner à ses élèves ébaubis, moi compris, un enseignement grandiose basé sur les perspectives de Mantegna et de Piero della Francesca et sur les programmes monarchiques d’un De Gaulle aux affaires.
« Je veux tout ça pour la fin de la semaine ! Démerdez-vous ! Sortez de l’atelier, nom de Dieu ! Je veux que vous écumiez toutes les galeries de peinture du Quartier Latin, les bords de la Seine, le Louvre dans ses soutes, les monastères cisterciens de Chartreuse, les allées de Versailles, les ciels de Paris, les pigeons en vol, Rome ! Partez ! »
Et nous partions, déboussolés de tant de liberté et fiévreux de saisir par le dessin cette répétition musicale qui sortait spontanément sous son crayon et, par voie de conséquence, sous le nôtre, comme une ode à ces rayons cosmiques et telluriques que j’allais découvrir sous mes baguettes de géobiologue vingt ans plus tard.
C’était un homme au geste inspiré. Clignant des yeux, mastiquant sa langue comme un bonbon, d’une immobilité et d’une raideur de pêcheur à la ligne, en dessinant, il engageait toute sa personne dans une attention d’orfèvre pour saisir sans faillir ce bourdonnement de la vie qui s’exprimait devant son regard fixe. Puis devant le nôtre, par la contagion du dessin, par le rythme des formes saisies et des mouvements décomposés, nous le suivions sans faillir. Comme Matisse au trait pur, sa trace dessinée sur le papier était toujours ample, sobre, simple, exacte, rapide, sèche. Ce trait de charbon que le bras accompagnait sans qu’il soit possible d’en prévoir la fin, ni le trait suivant, avait quelque chose dans son accomplissement graphique qui nous laissait tous sans voix autour de lui. Je n’ai ensuite retrouvé chez personne d’autre cet engagement, sauf peut-être chez certains chefs d’orchestre à la baguette précise et fulgurante, dans la direction de grandes symphonies. Trente ans avant Frank Gehry, Jean Faugeron exerçait son activité magistrale, de concert avec ses élèves médusés, dans une étude attentive des rythmes, imprimés dans la vie et, par voie de conséquence, dans l’architecture.
Son approche si sensible du vol des oiseaux, dont il captait par le dessin dans un même geste l’instant et le mouvement – celui du dessin des nuages dans les ciels parisiens, celui des effets et des désordres kinesthésiques des ordres classiques, depuis les filigranes et palmettes des feuilles des arbres jusqu’aux effets cinétiques des profils de toitures parisiennes en zinc –, son regard neuf mesuraient la répétition graphique du monde, dans l’intuition silencieuse et inexprimable de ses pulsions vibratoires.
Ce comportement fulgurant ne se réduisait pas à une simple virtuosité. En effet, comment ne pas lui rendre aujourd’hui hommage en examinant avec attention l’œuvre d’un Frank Gehry, dont la liberté d’expression architecturale repose sans le savoir sur ce grand ancien, dont seuls ses concurrents mandarins, ses anciens collaborateurs et ses élèves se souviennent aujourd’hui. Ses silences confondants devant nos travaux nous faisaient nous perdre en conjectures.
Gigantesques maquettes découpées au ciseau et à la pince- monseigneur, martyrisées jusqu’à point d’heure, courses échevelées pour dénicher des locaux parisiens à l’échelle de nos projets titanesques, équipes rapprochées au bord du suicide et des larmes, clients publics et privés sous le charme de la création la plus folle : tout dans la méthode de travail, l’architecture déliée et libre, et le talent rapproche ces deux hommes, hormis la reconnaissance dans l’histoire de l’architecture – accordée au second et soustraite au premier.
Jean Faugeron exerçait son activité magistrale trente ans avant Frank Gehry.
De ce cénacle artistique fiévreux qu’il commandait avec majesté ne reste en héritage que la pratique des rythmes en architecture, à l’instar de Corbu, héritage-clé remis en mains propres à ses élèves pour une meilleure compréhension du monde vibratoire de l’espace. C’est de ce rythme, c’est de cette subtile déclinaison du temps divisé, compté, propre à chaque espèce humaine, animale et végétale, déclinaison enfin rationnelle puisque inscrite et reconnue dans l’espace, que nous traiterons ici.
D. José luis sert
Je suis resté dix-huit mois chez J. L. Sert, dix-huit mois d’une formation professionnelle si rigoureuse, si inspirée, si riche que ma vie s’en est trouvée réorientée. Orientée vers les hommes et non plus vers l’Histoire, vers le constant souci de la bonne proportion et de la mesure de la construction rapportée à celle des dimensions du corps humain, vers la sobriété du trait et le sens donné à la chose, vers la place de l’objet construit dans la ville et sa respiration en sa qualité d’intrus dans un environnement qui ne l’attend pas... J’avais pour outil principal le Modulor que Corbu avait mis dans la main de Sert et qu’il me transmettait à son tour, comme d’ailleurs à tous les étudiants de Harvard dont il dirigeait l’école d’archi et qu’il engageait comme stagiaires au bureau.
En effet, de tous les projets élaborés au sein de son agence à Cambridge, Européens et Américains, confondus dans un même élan puissant, sourcilleux et attentif à chaque mesure pesée, veillaient à ce que la conception architecturale ne déroge à aucune règle mathématique : la hauteur d’un linteau, le balancement d’un escalier, les trois mesures d’une baie, la largeur des circulations, d’une cour, d’une rue, la dimension des universités, toute mesure devait s’y rapporter avec exactitude, quitte à prolonger tard le soir et toute la fin de semaine cette application du Modulor, transcendée dans une recherche incessante de la mesure la plus humaine et la plus appropriée.
Chez Sert, avec le Modulor, j’ai vécu un rite initiatique de gosse à qui un mentor inspiré donne des réponses précises aux questions qu’il se pose, sans pouvoir les formuler clairement. Son architecture réunissait dans une approbation et une admiration silencieuses le commun des mortels et le plus sophistiqué des intellectuels. Pour qui a visité la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, ses bâtiments à la fois riches et sobres, son urbanisme de cité grecque et son jardin d’Éden, la place donnée à Giacometti, à Miró, à la lumière dedans et dehors, à l’eau dirigée, aux grands pins rugueux immobiles, à l’espace silencieux et au silence construit, écouté, pour qui a ressenti dans son âme l’impression d’être attendu et accueilli avec respect dans des murs de jardin structurés par l’œuvre artistique et des sculptures qui s’inclinent ou font hello à son passage, pour qui sonne le clocher du village et ainsi mesure l’éloignement du bruit oppressant de la conurbation, pour qui chante son âme caressée par tant de sérénité, pour celui-là n’aura pas de mystère l’émotion qui a guidé mes pas pendant ces dix-huit mois de rêve et de travail sur la planche à dessin, sous l’aile capricieuse, l’œil exigeant et le verbe court du Maître José Luis.
Dominique Pétry-Amiel
Si cet extrait vous a intéressé,
vous pouvez en lire plus
en cliquant sur l'icone ci-dessous
