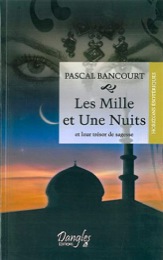AUX SOURCES DES MILLE ET UNE NUITS

© istock
Le recueil de contes appelé en arabe Alf layla wa layla, Les Mille et Une Nuits, nous vient d’un temps où brillait une civilisation savante et raf- finée qui eut pour point de mire la prestigieuse cité de Bagdad. La capitale de l’empire arabe, que le calife Al-Mansour fonda en 762 sur les bords de l’Euphrate, devint le centre du monde arabo-musulman et aussi, pourrait- on dire, la capitale intellectuelle du monde civilisé. À son apogée, sa population cosmopolite parlait toutes les langues, et diverses religions s’y côtoyaient dans une mosaïque de peuples. Les poètes ont exalté la beauté de la ville avec ses palais, ses maisons d’un luxe inouï, ses mosquées, ses jardins et ses bains publics. Sa verte campagne, arrosée par les réseaux d’une technique élaborée, offrait l’image du paradis terrestre. Dans le reste de l’empire, l’irrigation fit verdir les sols, favorisant la diffusion de nouvelles cultures, tandis qu’un artisanat réputé se développait, avec parmi bien d’autres activités la joaillerie, l’orfèvrerie, la céramique, le tissage, la maroquinerie... En même temps, les marchands arabes entretenaient des relations dans toute la Méditerranée, en Asie du Sud et jusqu’en Extrême-Orient.
Le déplacement de la capitale arabe de Damas vers Bagdad, qui suivit le remplacement de la dynastie omeyyade par les Abbassides, entraîna des conséquences majeures ; l’intellectualité arabe, en se rapprochant des limites orientales de son domaine, s’enrichit au contact des aires persane et indienne. À l’héritage culturel méditerranéen se superposa l’héritage asiatique, et la splendide cité de Bagdad, située à un croisement de civilisations, devint un creuset intellectuel où les arts furent poussés au raffinement. Ses philosophes, ses musiciens, ses artistes et ses savants élaborèrent une culture de premier ordre en assimilant les antiques sciences des Mésopotamiens, des Égyptiens, des Grecs, des Perses et des Indiens. C’est ainsi que les Arabes découvrirent la numérotation indienne, qui favorisa tant l’ingénierie et la recherche scientifique. À Bagdad, l’université al-Mustansria, qui fut la première université au monde, contribua à la renaissance de l’esprit humain ; en rassemblant toutes les connaissances de l’époque, elle devint un foyer de développement scientifique. Son impulsion anima les autres universités du monde musulman, que l’Occident chrétien prendra pour modèles ; Bassora, Samarcande, Damas, le Caire, Kairouan, Fez, Marrakech, Grenade et Cordoue reprirent le flambeau d’al-Mustansria. Les sciences et les arts se propagèrent dans ce terrain propice jusqu’aux portes de l’Europe, dont l’obscurité fut tempérée par les lumières de l’Orient.
C’est cet espace culturel, fruit d’un grand métissage, qui vit paraître Les Mille et Une Nuits. Le monde arabe musulman a repris ce corpus dont l’origine lui était étrangère. La thèse dominante veut que le fond originel vienne de l’Inde et qu’il ait gagné la Perse, où il aurait été recomposé et enrichi pour donner naissance à un premier recueil appelé le Hazar Afsana, Les Mille Contes (1). Cette œuvre, qui rapporte l’histoire de Shahrâzâd (Shéhérazade), aurait été traduite en arabe à Bagdad, à une époque que l’on situe autour de la seconde moitié du VIIIe siècle, quand des secrétaires persans firent connaître des textes de leur culture d’origine. Au cours des siècles, les conteurs arabes ont recopié et embelli ces fables indo-iraniennes islamisées, qu’ils adaptèrent à leur milieu culturel, tandis que des ajouts ultérieurs inté- grèrent au corpus des récits de l’Arabie préislamique, de l’Égypte antique, des Grecs, des Syriens, des Hébreux, des zoroastriens et des soufis. À partir de ces sources diverses, d’inspiration islamique et préislamique, les auteurs successifs des Mille et Une Nuits ont ciselé une œuvre originale, devenue le reflet vivant d’un monde en effervescence.
Il n’est pas sûr que le recueil indo-persan du Hazar Afsana soit parvenu aux Arabes avec un nombre d’histoires égal à mille, et c’est probablement en lui agrégeant des contes d’origines diverses, grecque, persane ou arabe, que les lettrés seraient parvenus à ce total symbolique. En passant de Perse en Arabie, la division en contes fit place à une division en nuits. Par la suite, les fameuses nuits de Shéhérazade atteignirent le nombre intriguant de mille et une. L’auteur anonyme de ce titre tant renommé, Les Mille et Une Nuits, eut la bonne inspiration ; l’œuvre n’aurait pas rencontré le même succès si elle avait gardé son intitulé initial des Mille Nuits. Le nombre mille fait référence à l’éternité, au dépassement de la durée liée à l’existence terrestre ; il laisserait néanmoins la sensation confuse d’une œuvre inachevée, alors que le nombre mille et un marque un aboutissement. Il est dit, dans l’épilogue de la version Mardrus (2), que la nuit après la millième « devint la date d’une ère nouvelle ». Le nombre mille et un débute et se termine par le chiffre un, car pour passer au degré supérieur et atteindre l’éternel présent, il faut revenir à l’origine de toute chose, à l’Unité, la réalité ultime qui prime sur tout le reste(3). L’unité qui s’ajoute à cet ensemble de mille nuits le transcende et l’accomplit, parce que cette unité compte plus à elle seule que les mille autres.
Dans presque tous les manuscrits dont on dispose, les récits, dont plusieurs s’enchaînent entre eux par un emboîtement en tiroir, se greffent sur le cadre initial que constitue l’histoire de Shéhérazade. Ainsi, dans un conte raconté par Shéhérazade, des personnages relatent l’un après l’autre leur propre histoire; l’un de ces interlocuteurs rapporte l’aventure d’un autre personnage, lequel à son tour raconte d’autres histoires... Cette structure ouverte et souple facilita, à différentes époques, l’incorporation de nouveaux contes à ce noyau que forment les fameuses nuits de Shéhérazade. L’une de ces ères les plus fécondes remonte aux IXe et Xe siècles, sous le califat abbasside, avec plusieurs récits où interviennent le calife Haroun al-Raschid et son vizir Giafar. Une autre phase importante se situe au Caire à partir du XIe ou XIIe siècle, sous le califat fatimide, avec un nouvel apport de contes merveilleux. Le recueil acquit une forme stabilisée vers le XIIIe ou le XIVe siècle, avec des textes en prose parsemés de poèmes, mais les rédactions se poursuivirent jusqu’au XVIIIe siècle.
En 1704, le Français Antoine Galland, à partir de manuscrits qu’il rap- porta de Syrie, publia la première traduction des Mille et Une Nuits dans une langue européenne. Son édition, retraduite en d’autres langues, remporta un succès immédiat. La découverte des Mille et Une Nuits suscita en Europe un engouement pour l’Orient et ses mystères qui n’est jamais retombé depuis, l’œuvre n’ayant cessé d’occuper l’imaginaire occidental avec une constante faveur. Dans les années qui suivirent, de nouvelles traductions furent entre- prises dans tous les pays. Entre-temps, on découvrit d’autres manuscrits arabes, porteurs de récits inédits. Ces originaux, traduits en adaptant l’écriture au goût littéraire de leur époque, donnèrent lieu à de nouvelles versions. Celle que publia Joseph-Charles Mardrus, au début du XXe siècle, relança l’intérêt des milieux artistiques pour Les Mille et Une Nuits.
C’est Antoine Galland qui inséra à son recueil les fameuses histoires d’Aladin, d’Ali Baba et de Sindbad le marin, que Joseph-Charles Mardrus a reprises dans sa version. Partant de cette constatation, des exégètes modernes prétendent exclure des Mille et Une Nuits ces récits qui ne s’y trouvaient pas à l’origine, en dépit du fait que leur éviction priverait le livre de ses figures les plus notoires. Mais les fervents supporters des Mille et Une Nuits, peu soucieux de ces considérations érudites, auront du mal à accepter qu’on ampute l’œuvre des fictions qui contribuèrent pour beaucoup à sa renommée. Sindbad, Aladin et Ali Baba sont désormais trop bien intégrés aux Nuits, tant par l’habitude ancrée dans les esprits depuis des générations que par le style de ces histoires, qui s’accordent fort bien au goût de leur famille d’accueil. Ces contes ont gagné une légitimité telle que les versions arabes ultérieures les ont adoptées. Antoine Galland ne fut d’ailleurs pas le premier à grossir ce répertoire d’ajouts divers ; bien avant lui, les rédacteurs arabes n’ont cessé d’insérer des contes à cet assemblage, pour lequel on ne connaît aucune fixation définitive qui puisse servir de référence.
Sur le théâtre des Mille et Une Nuits que constitue la communauté arabe musulmane vécurent d’autres groupes religieux comme les chrétiens, les juifs et les zoroastriens. La cohabitation a parfois donné lieu à des réactions d’incompréhension, mais les rédacteurs des Mille et Une Nuits firent preuve d’un esprit d’ouverture tout différent de l’étroitesse qu’ont pu afficher quelques-uns de leurs contemporains. Les contes mettent en scène un islam tolérant, ouvert sur l’universel et prêt à intégrer les éléments étrangers susceptibles de l’enrichir, qu’ils soient de source indienne, iranienne, grecque ou chrétienne. Les penseurs musulmans ont proclamé ce qu’ils devaient à ces divers fonds doctrinaux, qu’il s’agisse du christianisme oriental, du mazdéisme persan ou de la philosophie grecque, avec en particulier le pythagorisme et le néoplatonisme. Il faut également tenir compte de l’apport hébreu et chinois, ainsi que de l’héritage mésopotamien transmis par les Sabéens.
Les territoires devenus musulmans abritaient en outre d’anciens cultes préislamiques dont la plupart héritaient de très vieilles mythologies; ces mythes étaient porteurs d’un message ésotérique dont peu de gens, à l’exception de quelques sages, saisissaient la portée. Dans la péninsule arabique, une spiritualité vivante précéda longtemps l’apparition de l’islam ; la Mecque fut une cité sainte où les Bédouins se rassemblaient autour de la Kaaba, l’édifice cubique qui fut un sanctuaire polythéiste avant que Mahomet n’efface de ses murs toute figuration. L’intolérance de certains califes n’empêcha pas d’autres courants ésotériques, comme celui des Sabéens et celui des Coptes, de se répandre dans les pays arabes depuis l’Égypte et la Mésopotamie. Les Sabéens, les derniers héritiers de l’ancienne Chaldée, survécurent quatre siècles en terre d’islam, où la religion dominante fut à leur égard tantôt tolérante tantôt sectaire. De ces sources diverses, Les Mille et Une Nuits ont repris les enseignements que la brillante imagination arabe reformula en récits allégoriques, assortis à leur environnement culturel et religieux.
La spécificité arabe des Mille et Une Nuits se voit dans leur cadre géo- graphique, avec des villes comme Bagdad, Bassora, Le Caire, Damas ou Alep. Des acteurs connus de l’histoire arabe, à l’exemple du calife Haroun al-Raschid et de son vizir Giafar, trouvent place dans les contes, le procédé consistant à ancrer le récit dans la réalité historique et géographique ayant été maintes fois utilisé pour capter l’attention de l’auditoire. Il arrive cependant que les histoires confondent les époques et les personnages dont certains, en tout anachronisme, furent déplacés en des siècles antérieurs ou postérieurs à ceux où ils vécurent. C’est ainsi que Shéhérazade s’adresse au roi Shâhriyâr, dont la dynastie sassanide dirigea la Perse du IIIe au VIIe siècle, pour lui parler d’Harounal-Raschid qui régna aux VIIIe et IXe siècles! Cette liberté prise avec la chronologie n’est pas un signe d’incurie intellectuelle; elle invite le lecteur à rejoindre la dimension intemporelle où se positionne l’œuvre. C’est dans cet espace élargi, affranchi des oppositions entre le passé et le présent, entre le possible et l’impossible, et entre le réel et l’imaginaire, que le conte délivre sa parole.
Les besoins du message ont parfois obligé les contes à embellir leurs acteurs. Le plus connu d’entre eux, Haroun al-Rachid (Aaron le Juste), cinquième calife de la dynastie abbasside, régna de 786 à 809, à une période considérée comme l’âge d’or de la civilisation arabo-musulmane. En sa qua- lité de calife, « remplaçant » du Prophète, il exerçait l’autorité sur tous les musulmans à l’exception de ceux d’Espagne. Les Mille et Une Nuits ont beaucoup contribué à la célébrité posthume de ce souverain, même si la réa- lité historique du personnage, qu’il serait plus exact de comparer à un Saddam Hussein, fut bien éloignée de l’image enjolivée qu’elles donnent de lui : celle d’un souverain sévère mais généreux, proche de ses sujets, redres- seur de torts et garant de la justice. À la vérité, ce despote se montra aussi capricieux, cruel et débauché que pouvait l’être un monarque oriental, gavé de cruautés gratuites et blasé des nombreuses femmes recluses à sa merci dans son harem.
Haroun al-Rachid laissa le soin de gouverner à son vizir Giafar, de la famille d’origine perse des Barmécides, à qui les califes accordèrent leur confiance depuis le début de la dynastie abbasside. Le très élégant et cultivé Giafar fut un intime d’Haroun al-Rachid, jusqu’au jour où ce monarque prit ombrage de la puissance et de la fortune des Barmécides, qui avaient pourtant contribué pour beaucoup à sa gloire. Par une décision digne d’un psychopathe, il fit trancher la gorge à Giafar et maltraiter son cadavre. Le frère de Giafar ainsi que leur père, l’ancien grand vizir Yahia, furent jetés dans des culs-de-basse-fosse, et les Barmécides bannis de toute charge officielle. Pour le reste, Haroun al-Rachid fut un gouvernant de faible envergure ; il n’eut qu’à profiter du pouvoir qu’avaient consolidé ses prédécesseurs, Al-Mansour et Madhi. Son originalité tient à l’habileté avec laquelle il sut utiliser le luxe et les fastes comme instruments politiques. Après une triste fin de règne marquée par l’intolérance religieuse, il laissa son empire dériver sur la voie du déclin et de l’éclatement(4). Ainsi donc, chaque fois que le calife Haroun al-Rachid interviendra dans un conte comme symbole vivant de la Justice divine, il faudra pousser très loin l’abstraction quant à ce que fut la sinistre réalité du personnage.
Plusieurs facteurs contribuèrent à la décadence de l’empire arabe. Sur le plan politique, le califat abbasside fut inapte à sauvegarder son unité. Comme l’a expliqué Fabre d’Olivet(5), une carence abrégea la durée de ce régime, du fait que Mahomet n’avait guère songé à séparer l’autorité spirituelle du pouvoir temporel, de sorte que ses successeurs reprirent sur leurs épaules la double charge que seul un prophète inspiré avait pu exercer conjointement. L’empire, dont la prospérité reposait pour beaucoup sur l’esclavage, déclina sous l’effet combiné de l’incurie administrative et des révoltes qu’entraînèrent les injustices sociales. Sur le plan intellectuel, un véritable recul prit date en 1019 quand le calife al-Qadir, sous la pression de théologiens sunnites, interdit toute nouvelle interprétation du Coran et du hadith en décrétant la « fermeture des Portes de l’Ijtihad », les portes de la libre réflexion, sous prétexte que la recherche étant achevée, il ne restait plus qu’à appliquer les explications qu’en avaient données les écoles juridiques. Les docteurs de la loi ne trouvèrent rien de mieux, pour préserver leur pouvoir clérical, que d’amputer le message prophétique d’une dimension ésotérique qui leur échappait. Cet acte officiel, qui mit fin au libre examen, stérilisa la pensée arabe pour des siècles. Depuis cette date fatale, l’Orient arabe renonça à renouveler son inspiration et s’enferma dans une rigidité qui le condamna à une longue décrépitude.
Après le pillage de Bagdad par les Mongols en 1258, la capitale ruinée ne fut plus que l’ombre d’elle-même ; mais le souvenir de sa splendeur passée et son apport à la civilisation universelle ont continué à nourrir la fierté des Arabes. Le califat abbasside, malgré les difficultés qui marquèrent son règne, reste auréolé du souvenir d’une époque florissante. Une majorité d’Arabes musulmans, Maghrébins y compris, garde la nostalgie d’un âge d’or où le natif de Bagdad, du Caire ou de Damas se serait senti chez lui dans chacune de ces cités, où les palais ouvraient leurs portes aux plus humbles des visiteurs, et où le commerce rapprochait les gens plus qu’il ne les opposait. À l’heure actuelle, à la suite de ce qu’il faut bien appeler « l’extinction des lumières », les Arabes, confrontés à l’importation brutale de modèles politiques étrangers sous forme de régimes policiers ou corrompus, vivent mal le décalage entre la confusion du présent et la nostalgie de leur ancienne splendeur.
Les califes ont parfois favorisé l’effervescence intellectuelle et artistique, avec pour arrière-pensée politique de profiter de ses retombées, mais ils n’en furent pas les inspirateurs. L’éclat de la civilisation arabo-musulmane tenait à un tout autre facteur ; elle résultait de la présence en son sein de grands sages inspirés qui lui servirent de flambeaux. On a appelé de noms divers – maîtres, cheikhs, saints ou guides – ces porteurs de lumière. Une connotation affectueuse leur a valu les noms de Père ou de Mère, car le monde musulman compta des femmes parmi ces vénérables personnes. De cette élite qui œuvra à l’élévation spirituelle du monde, l’Histoire a retenu des noms illustres comme Ibn Arabi, Rumi, Ghazali, Ibn al-Farid, Abd al-Qadir al-Jilani ou Rabi’a Adawiyya, mais la plupart, peu soucieux de renommée, sont restés anonymes et ne furent connus que du petit nombre de leurs élèves, à l’instar des artistes du Moyen Âge qui laissèrent un témoignage de leur talent sans signer leurs œuvres. Ils n’en exercèrent pas moins une influence capitale.
Ces grands sages honoraient la religion musulmane, mais quelques-uns parmi eux connaissaient la valeur des anciens cultes préislamiques qui avaient autrefois prévalu sur le terrain où prêcha Mahomet. Ces anciennes croyances, même sous leur forme polythéiste, n’ignoraient pas l’Unité divine. Dans les anciens temps, on n’avait nul besoin de formuler de toute force cette vérité, tant elle paraissait évidente ; c’est parce que les hommes l’avaient perdue de vue que la prédication de Mahomet dut énoncer avec autant d’insistance l’absolue unicité de Dieu(6). Une mythologie dégénère en superstition quand son symbolisme n’est plus compris ; c’est alors que ses figures polythéistes tournent à l’idolâtrie. Mahomet, en récusant les résidus de polythéisme hérités des anciens cultes, s’efforça d’écarter tout risque de semblable déviation. La foi nouvelle assainit l’entendement des fidèles et épura les mœurs des populations converties. Son action éducatrice cultiva dans le peuple la droiture, la charité, l’hospitalité et l’humilité devant Dieu, tandis que la négation de tout intermédiaire entre Dieu et l’homme chassa la superstition, car le vaste domaine qui s’étend entre la Divinité et le monde terrestre, que les anciens cultes peuplaient d’entités fabuleuses, ne serait plus surchargé d’éléments suspects de fantasmagories. Non que l’islam nie l’existence des êtres surnaturels, leur réalité étant même attestée par le Coran, mais sa pratique religieuse n’accorde à ces créatures aucun rôle décisif dans l’évolution spirituelle de l’individu.
Dans cet univers mental apuré, quelle place resterait-il pour les anciens mythes ? Les antiques mythologies, atteintes par le discrédit qui frappait le polythéisme, allaient-elles sombrer dans l’oubli ? L’enseignement ésotérique dont était porteur cet héritage allait-il se perdre sans remède à seule fin de ne pas heurter de sourcilleux gardiens du dogme? Des sages orientaux, conscients de l’enjeu, ne laissèrent pas disparaître un patrimoine hérité des âges antérieurs, dont l’origine remontait à l’aube de la pensée humaine. Leur intention ne visait en aucune façon à remettre en cause le message public de l’islam; ces maîtres se seraient bien gardés de nuire à la religion officielle à laquelle l’ésotérisme ne s’oppose nullement. Mais pour que l’héritage des temps anciens puisse survivre, son habillage dut changer ; il prit l’apparence de contes, très vite fixés sous forme écrite, que les littérateurs arabes allaient au cours des siècles ciseler et embellir. De surplus, l’expression par métaphores évitait d’engendrer un dogme rigide, préjudiciable à une pensée dont le fond reste insaisissable à un mental ordinaire.
Les références à Dieu et au Coran qui ponctuent Les Mille et Une Nuits ne sont pas l’effet d’un formalisme stéréotypé ; il ne fait aucun doute que ces textes soient profondément ancrés dans la religion musulmane, en dépit de l’apparence profane et irrévérencieuse que leur donnent parfois certains thèmes licencieux. L’héritage préislamique, patent dans les contes, ne signifie pas que Les Mille et Une Nuits aient voulu opposer un syncrétisme rival au monothéisme officiel. Il n’était certes plus pensable d’incarner l’Invisible sous l’aspect de dieux ou de déesses, car toute résurgence d’un polythéisme, même atténué, aurait entraîné de violentes accusations de retour à l’idolâtrie. En revanche, les êtres surnaturels, comme les fées ou les djinns, pouvaient subsister dans l’imaginaire des contes en tant que puissances bénéfiques, maléfiques ou neutres, dans la mesure où ces entités n’y font jamais l’objet d’une quelconque allégeance religieuse. Il est même attesté que nulle puissance, hormis celle de Dieu, ne peut s’imposer à un héros doté d’une volonté ferme.
Les contes ont bien pour source l’imagination, ce qui n’autorise pas à ne voir en eux qu’une fantaisie réduite à une simple récréation; l’imagination, dans son sens supérieur, n’est pas une libre divagation mais un outil de connaissance. Entre le monde sensible, physique, et le monde intelligible se trouve le monde qu’on a appelé imaginal pour le différencier de l’irréalité du monde imaginaire. Une chose peut exister, de façon tout aussi réelle, sur le plan physique, sur le plan imaginal ou sur le plan spirituel. C’est dans cet inter-monde imaginal que les réalités spirituelles prennent corps sous forme de visions prophétiques. Autrefois, les vrais savants avaient accès aux secrets des différents mondes parce que leur faculté intellective fonctionnait de concert avec leur faculté imaginative. L’interconnexion entre la pensée philosophique, la vision prophétique et la faculté imaginale inspira les contes, les fables et les épopées. Tout le secret des anciennes littératures indienne, iranienne et arabe tient à leur capacité à transformer la doctrine métaphysique en épopée, de façon à ce qu’elle devienne pour l’âme un événement partageable par un vécu. Grâce à ces récits visionnaires qui ne sont ni des idéologies ni des théories abstraites, l’humanité n’a pas entièrement coupé les liens avec l’univers spirituel et continue à se sentir concernée par lui(7).
Divers courants initiatiques ont laissé leur marque dans Les Mille et Une Nuits. En terre d’islam, le plus connu fut le soufisme; mais il en a existé d’autres, comme l’ismaélisme ou la naqshabandiya. Les Mille et Une Nuits furent composées à une époque où l’initiation était encore une pratique vivante ; avant qu’elle ne s’éteigne et que son savoir ésotérique ne se perde sans remède, ses représentants ont pris soin de figer un maximum de cet enseignement sous l’apparence des contes, à l’intention non seulement de leurs disciples vivants, mais aussi des esprits curieux qui, dans la suite des temps, sauraient percer leur signification.
Le soufisme représente l’ésotérisme ou l’intériorité de l’islam ; il se définit comme une voie initiatique ayant pour but d’atteindre la délivrance en dépassant les limites de l’individualité. Sa démarche repose sur une méthode éprouvée ; sous la direction d’un maître, le candidat suit un périple intérieur qui le conduit à gravir la hiérarchie de l’être, sans qu’un tel cheminement ne l’oblige à se retirer du monde(8). On trouvait des soufis dans toutes les couches de la société, des plus humbles aux plus élevées ; plusieurs d’entre eux furent médecins, commerçants ou artisans. Le soufisme inspira large- ment la culture, les arts et la littérature, la plupart des meilleurs représentants de ce que l’islam compta d’écrivains, de poètes, de philosophes et de savants ayant été soufis. À Bagdad, ce courant imprégna très tôt les milieux intellectuels, bien que le pouvoir ait parfois ressenti comme une menace le charisme des maîtres et l’influence des confréries. À certaines époques, le califat abbasside persécuta les mouvements ésotériques suspectés de mettre en péril l’ordre politico-religieux, et plusieurs soufis périrent victimes de son inquisition. De nos jours, le soufisme participe pour beaucoup au renouveau de l’islam, en dépit des fondamentalistes qui s’opposent à ses confréries.
----------------------
1. Nikita Elisséeff : Thèmes et motifs des Mille et Une Nuits (p. 20-23, Institut Français de Damas ; 1949).
2. II, 107.
3. Cheikh Khaled Bentounès : L’Homme intérieur à la lumière du Coran (p. 41-42, Albin Michel ; 1998).
4. Michel Gall : Le Secret des Mille et Une Nuits (p. 264-279, Laffont ; 1972).
5. Antoine Fabre d’Olivet : Histoire philosophique du genre humain (t. II, p. 83-84, L’Âge d’Homme; 1974).
6. René Guénon : Aperçus sur l’ésotérisme islamique et le taoïsme (p. 39, Gallimard; 2003).
7. Henri Corbin : L’Homme et son Ange (p. 250-253, Fayard ; 2003). 8. Éric Geoffroy : Initiation au soufisme (p. 11 et 19, Fayard ; 2003). 9. Gérard Chauvin : Soufisme (p. 31, Pardès ; 2001).
Si cet extrait vous a intéressé,
vous pouvez en lire plus
en cliquant sur l'icône ci-dessous