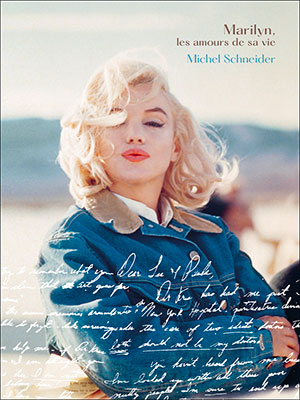Moi, Marilyn Monroe

Pourquoi cette permanence, presque cette éternité ? Le secret de sa présence après tant de temps ? Ses mariages ? Tous ratés. Ses amours ? Jamais heureux, chantait Aragon. Ses succès cinématographiques ? Aucun Oscar et peu de récompenses. À peine, en 1959, un Golden Globe de la meilleure actrice comique pour sa performance dans Certains l’aiment chaud. Sa vie brève et tra- gique, sa passion pour la psychanalyse, son errance entre sexe et drogues, amour et solitude l’ayant conduite à une mort prématurée ? Son suicide ? « Probable » déclara le coroner. Son assassinat, considéré comme fait historique par nombre de complotistes, thèse alimentant des centaines de livres ? Pas seulement. À travers tout cela, un fil rouge. La recherche du bonheur. « Tous les hommes recherchent d’être heureux, écrivait Pascal. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu’ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. La volonté [ne] fait jamais la moindre dé- marche que vers cet objet. C’est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Jusqu’à ceux qui vont se pendre. » Marilyn ne s’est pas pendue. Elle s’est probablement tuée, lentement, puis d’un seul coup un samedi soir de blues et de musiques tristes. Maldonne, comme moyen d’être heureuse, elle avait choisi le sexe. Elle le paya de sa vie passée à attendre l’amour.
Et nous ? En 2022 comme hier, Marilyn est une sorte de miroir. Elle nous parle de nous. De notre innocence, de notre cruauté. De ce que nous sommes : éperdus du désir d’être re- connus et consolés. Art, drogue, pouvoir, divertissement, sexe, elle nous parle de tout ce que nous faisons pour ne pas être ce que nous serons au bout de la nuit : solitaires et inconsolés. Elle nous parle en silence, et c’est cette vie bégayante, toujours au bord des mots pour se dire, qui nous la rend si proche.
Et pourquoi moi ?
Qu’est-ce qui me pousse aujourd’hui encore vers elle, long- temps après avoir écrit un roman (Marilyn dernières séances, 2006), noirci nombre de pages où j’évoquais ses traces, enregistré tant d’émissions de radio ou signé des scénarios pour des films documentaires ? Nostalgie de mes années de jeunesse où j’allais la voir dans Rivière sans retour (1954) ou Sept ans de réflexion (1955) ? Survie en moi de ce jeune homme de dix-huit ans plein de désirs et de rêves de femmes que j’étais lorsqu’elle mourut ? Fantasmes sexuels de l’homme adulte attiré par sa figure érotique provocante ? Fascination du psychanalyste que je suis et qui n’aurait pas aimé avoir à traiter un cas aussi lourd de peur d’être entraîné avec elle dans ce qu’on appelle une « fo- lie à deux » ? Identification pathétique à une célébrité morte toute seule ? Je ne suis pourtant ni célèbre ni seul. C’est plus simple. Je la vois. Je la revois comme si je l’avais connue. Douceur et amertume, innocence enfantine et sexualité crue, tristesse et beauté, joie et angoisse, Marilyn marche comme Holly Golightly, le personnage de Petit déjeuner chez Tiffany (1958) de Truman Capote, rôle qu’elle aurait tant voulu jouer au cinéma et qui fut donné à son opposée, Audrey Hepburn. Elle marche comme une funambule au-dessus du cirque de Manhattan. Je la vois, perdue dans ce gris de métal de New York qui vous coupe de votre semblable, flottant entre apparition et disparition. Elle me parle. Je l’écoute. Ses phrases hésitantes, si intelligentes. « J’ai toujours pensé que je n’étais personne. Et la seule façon pour moi de devenir quelqu’un... eh bien ! C’est d’être quelqu’un d’autre... J’ai l’impression que tout ce qui m’arrive concerne quelqu’un d’autre, à côté de moi. Je suis tout près, je sens ce qui se passe, j’entends, mais ce n’est pas vrai- ment moi... »
Ces autres phrases que je lui prête dans mon roman : « “Je reviens”, c’est ma devise. Mes voyages sont toujours les mêmes. Peu importe où je vais et pourquoi j’y vais, à la fin, je n’ai ja- mais rien vu. Être actrice de cinéma, c’est comme vivre sur un manège. Tu voyages, mais sur le manège, et partout, les gens du coin, tu ne les connais pas, tu ne les vois pas. Tu ne vois pas au-delà du décor. Juste les mêmes agents, les mêmes interviewers, les mêmes images de toi. Les jours, les mots, les visages semblent ne passer que pour revenir encore. Comme dans ces rêves où on se dit : j’ai déjà rêvé ça. C’est sûrement pour ça que j’ai voulu être actrice, pour tourner, justement, mais sur place, en revenant toujours au même endroit. Le cinéma est un manège pour enfants. » Elle me parle d’elle comme ces lignes de Pascal qui me hantent depuis mon adolescence et que j’ai retrouvées dans les lectures de Marilyn : « Je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le monde, ni que moi-même ; je suis dans une ignorance terrible de toutes choses ; je ne sais ce que c’est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste ».
Connaissez-vous beaucoup d’actrices qui recopiaient dans un carnet des phrases de Pascal ? Pensez donc : Blaise Pascal à Hollywood...
Tout cela est-ce d’elle ou de moi ? Dirais-je, comme on le fait dire à Flaubert à propos de son Emma Bovary : « Marilyn, c’est moi ? » Quand j’ai publié Marilyn dernières séances, j’ai cru avoir écrit le portrait de ma mère, de sa vie tragique. Il fallut la lecture profonde d’un ami écrivain pour m’ouvrir les yeux et me dire : « Mais re- garde, Marilyn, c’est toi. » Marilyn est mon miroir. Ses phrases, je ne sais plus si elle les a dites ou si c’est moi qui les lui ai fait dire dans un roman.
Je l’écoute, la regarde vivre et mourir, et je dis : « Moi, Marilyn ». Voilà une phrase qu’elle aurait eu beaucoup de mal à dire. Ce qu’elle dit sous la forme extrême de la dépersonnalisation nous concerne tous dans les moments où nous ne savons plus trop qui en nous dit « je » ou « moi ».
Pourtant, comme Odette de Crécy pour Swann, quand j’ai rencontré Marilyn, elle n’était pas mon genre. Pour paraphraser Aragon (« J’aimais déjà les étrangères lorsque j’étais un petit enfant »), je pourrais dire : « J’aimais déjà les actrices étranges (et étrangères) lorsque j’étais un adolescent cinéphile. »
Mais je n’aimais que les brunes et elle était blonde. Mes actrices : Ava Gardner, Gene Tierney, Jennifer Jones, Barbara Stanwyck qui me rappelait ma mère, avec cette même teinte de dureté, de cruauté, cette part de masculinité qui les rendait fatales. Attraction du phallus, disait Lacan.
Aux Marilyn Monroe et autres Jane Mansfield, interchangeables poupées roses et pulpeuses, féminines à l’excès, je préférais la filiforme et auburn Audrey Hepburn ou la nocturne, inquiétante et étrange rousse Kim Novak. Toutes les autres fêlées, dures, cruelles, mystérieuses, alcooliques ou nymphomanes que l’on devinait derrière l’écran. Sombres. Souvent au bord de la folie, mais pas la même que celle de Marilyn : une folie de femmes, pas d’enfant perdue. Leurs yeux vous tuent. L’enfer commence avec elles.
Ce qui m’a fait découvrir Marilyn — devrais-je écrire : ma Marilyn — ce n’est ni son corps aux courbes douces et puissantes ni son visage tout de tendresse et d’innocence, ce sont ses mots, à l’occasion d’un film d’Élisabeth Kapnist sur la psychanalyse à Hollywood dont j’étais le scénariste, Un Écran nommé désir (2006). Derrière Marilyn Monroe, la ravissante blonde idiote (dumb blonde) qui savait jouer très intelligemment de sa feinte bêtise dans des films comme Les Hommes préfèrent les blondes, Le Milliardaire ou Sept ans de réflexion, j’ai découvert une Marilyn aux cheveux châtains ou bruns-roux, mélancolique, plus proche de Saturne que du soleil.
Marlon Brando, à sa mort, déclara : « Personne ne pouvait comprendre comment une fille qui a le succès, la gloire, la jenesse, l’argent, la beauté, peut-elle se tuer elle-même, personne ne pouvait comprendre cela car ce sont des choses que tout le monde veut, et les gens ne peuvent pas croire que la vie n’était pas importante pour Marilyn Monroe, que sa vie était ailleurs. » Où, ailleurs ? Parmi les mots, les livres, la littérature. Un seul exemple : lors du tournage de Nid d’amour (1951), on la voit lire Proust.
Michel Shneider
Si cet extrait vous a intéressé,
vous pouvez en lire plus
en cliquant sur l'icône ci-dessous :