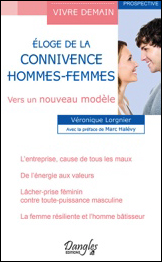Nous vivons au coeur d'une société occidentale à bout de souffle

Les sujets de conversation lors des dîners de famille ou entre amis et les discussions en terrasses de café ont tendance à se rapprocher des sujets de réflexion abordés lors des séminaires professionnels et des conventions d’entreprises. Les informations communiquées par les différents médias (télévision, radio, internet) vont aussi dans le même sens, à savoir que les préoccupations majeures des Français convergent autour de ces sujets :
● nous sommes stressés, et le stress est une maladie, pas uniquement une question de confort ;
● les différentes fractures (sociale, territoriale, et générationnelle) plombent le moral, et donnent une ambiance propice à la morosité ;
● notre planète Terre se transforme en poubelle et se vide de ses ressources.
Pour contrebalancer ces constats « négatifs », on observe une série de bonnes nouvelles, tout autant partagées par l’ensemble de la société : une amélioration de la relation hommes-femmes, plus de temps de loisirs, et une certaine qualité des relations au sein des cellules familiales.
Bien entendu, la liste est non exhaustive ; il ne s’agit pas de faire ici un bilan psychosocial ou un baromètre du moral des Français !
Ces phénomènes sont les effets de causes présentes en amont ; interroger ces phénomènes a pour but de voir comment ils se relient, et ainsi repérer l’ébauche d’une cause qui nous éclairerait différemment sur les dysfonc- tionnements de la société.
Stress et rapport au temps
L’horloge comtoise de nos grands-parents égrenait le temps, imperturbable. Une seule pendule pour tous, la même journée, les mêmes vingt-quatre heures, chacun se pliait au rythme du balancier et occupait ce temps sans le remettre en question.
Ceux qui avaient beaucoup de travail n’avaient pas à l’esprit de dire qu’ils manquaient de temps ; seules peut-être les jeunes filles oisives de la bourgeoisie espéraient parfois accélérer l’écoulement des jours quand elles se languissaient du retour de l’amoureux.
Aujourd’hui, tout est différent, le temps est un sujet de préoccupation majeur pour les habitants des pays occidentaux. manquer de temps, être pressé, être stressé parce que l’on manque de temps, ces expressions du temps en manque sont devenues un pilier autour duquel dansent les hyperactifs de notre société. Ils se dépêchent, ils sont efficaces, organisés, ils planifient, ils optimisent, ils font des listes : leur journée est une course, leur semaine un marathon. « Pourvu que j’arrive au bout de la journée en ayant fait ce que j’ai à faire ! »
Tout a une visée d’utilité chez ceux qui manquent de temps : ils profitent des vacances, des pauses, des week-ends pour revenir en forme et reprendre la course de plus belle. d’ailleurs, la course ne s’arrête pas vraiment pendant le week-end (« y a tant à faire ! »). Pendant les vacances, ils font du sport, des visites, de la cuisine, du bricolage, des activités...! Sauf les premiers jours : épuisés en arrivant (un peu déprimés aussi parfois devant l’agenda vide), il leur arrive souvent de passer les quatre ou cinq premiers jours des vacances à dormir !
À côté de ceux qui courent après le temps, il y a ceux qui s’ennuient et cherchent à passer le temps, voire à le tuer ! Je ne parle pas des enfants, pour qui l’ennui est source de possible créativité, mais des adultes qui n’ont pas suffisamment de centres d’intérêt pour occuper leur temps d’inactivité. Ceux-là sont heureux du temps qui passe vite, ainsi n’ont-ils « pas le temps de s’ennuyer ».
Ceux qui vont manquer de temps vont être davan- tage enclins au besoin de profiter, ceux qui ont une tendance à l’ennui vont chercher du divertissement.
Les chercheurs de temps vont vouloir le saisir pour mieux le retenir, d’où l’expression « prendre son temps », afin d’en « profiter », d’en tirer bénéfice. Profiter signifie aussi « faire des progrès en vertus, en sagesse » : le temps profitable a pour but d’être bénéfique à notre vie en général.
Quand on se divertit en s’amusant ou en « re-créant » (récréation, récréatif) de ce qui fatigue ou préoccupe, on recharge les batteries pour retourner à sa tâche. « Divertir » signifie aussi détourner d’un dessein, et « faire diversion » signifie détourner l’attention.
On peut donc profiter et se divertir de manière béné- fique, comme une fuite hors du temps, qui dans ce cas ne sert qu’à ne pas être dans le temps qui passe ; car il y a ceux qui ni ne poursuivent, ni ne sont poursuivis par le temps : ils respirent ! Ceux qui respirent avec le temps vivent le temps qui passe !
J’anime par exemple régulièrement des séminaires avec un collègue homme (mais qui pourrait tout aussi bien être une femme pour ce que je partage ici) qui, pris de panique à l’idée qu’il n’aura pas assez de sujets à aborder, tente de faire rentrer dans le programme assez d’informations pour occuper une semaine entière ! (et moi de plaisanter en disant que s’il n’arrive pas à tenir avec son propre « matériel » pédagogique, je prendrai le relais en improvisant). J’ai constaté cette peur de ne pas durer assez longtemps chez nombre de confé- renciers ou formateurs qui attendent la fin du temps imparti pour donner l’essence du contenu ou le meilleur d’eux-mêmes. À l’inverse, il y a ceux qui disent tout et tout de suite : dans les trente premières minutes de la conférence, vous avez déjà tout eu et le reste n’est que remplissage !
D’après RSE News, le stress est à l’origine de 50 à 60 % de l’absentéisme au travail en europe. C’est le deuxième plus important problème de santé après le mal de dos (l’étude ne fait pas de lien entre le mal de dos et le stress).
Selon l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le stress survient « lorsqu’il existe un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ».
Je m’appuie sur la définition du stress que m’a enseignée dominique Baumgartner1 : « Le stress est la rupture du contact avec la réalité : l’humain n’est pas stressé à l’origine, c’est un conditionnement. Le stress vient d’une pensée qui impose à l’individu de répondre à une chose alors qu’il n’a pas l’énergie disponible. C’est parfois, et même souvent, le signe d’une déficience de l’être, et une inflation de l’avoir et/ou du faire. »
Les effets du stress sont à la fois de nature physique (douleurs, troubles du sommeil, etc.) et psychologique (modification du comportement, difficultés à se concen- trer, à prendre des décisions, etc.).
Parmi les différentes catégories de facteurs du stress au travail, on distingue celles liées :
● au contenu du travail à effectuer (exemple : charge de travail) ;
● à l’organisation du travail (exemple : répartition des tâches) ;
● aux relations de travail (exemple : absence de reconnaissance) ;
● à l’environnement physique et technique (exemple : nuisances sonores) ;
● à l’environnement socioéconomique de l’entreprise (exemple : incertitude sur l’avenir de celle-ci).
Le stress est la conséquence d’un nombre impor- tant de maladies cardiovasculaires, de dépressions et de troubles musculo-squelettiques (TmS). Une étude de l’inrS estime que le coût du stress professionnel a représenté au minimum 2 à 3 milliards d’euros en France en 2007 (dépenses de soins, absentéisme, cessations d’activité, décès prématurés).
L’étude n’a pas pris en compte la dimension du coût du stress pour l’individu, à savoir la souffrance et la perte de bien-être (il est admis qu’ils peuvent représenter jusqu’à deux fois les coûts des soins et des pertes de richesse).
En europe, le coût économique annuel du stress au travail dépasserait les 20 milliards d’euros.
Le Bureau international du travail estime que les pertes de qualité, l’absentéisme et le turnover résultant du stress représentent entre 3 et 4 % du PiB des pays industrialisés.
Ces résultats sont stupéfiants, tant on a l’impression que le collectif a baissé les bras devant sa gravité. La question semble avoir pris une telle ampleur que chacun est pétrifié, préférant considérer le stress comme un facteur concomitant des modes de vie du xxie siècle !
La souffrance au travail
Voici les chiffres fournis par le ministère du Travail :
● en dix ans, les troubles musculo-squelettiques sont passés de 1 000 à 35 000 par an.
● en 2005, il y a eu 760 000 accidents du travail en France. deux personnes par jour meurent dans des accidents du travail.
● deux millions de salariés sont victimes de harcèle- ment moral et de maltraitances, 500 000 de harcè- lement sexuel.
● Le coût annuel des accidents du travail, des mala- dies professionnelles et de la maltraitance s’élève à 70 milliards d’euros pour l’État et les entreprises.
● Sur 5 ans, on a constaté plus de 1 000 tentatives de suicide sur les lieux de travail en France dont 47 % ont été suivies de décès.
● 10 % des dépenses de la Sécurité sociale sont directement liées aux maladies professionnelles.
● eczéma, insomnies, alertes cardiaques, troubles musculo-squelettiques, ulcères, cancers, dépressions, tentatives de suicide sont les conséquences les plus fréquentes des maltraitances sur les lieux de travail.
● durantladernièreannéejuridictionnelle,lestribunaux des prud’hommes ont traité 250 000 litiges.
Le but n’est pas d’analyser ces chiffres, mais d’ana- lyser le processus d’analyse : je suis interpellée par le nombre de phénomènes répertoriés dans les sources de souffrance au travail.
La manière dont est faite cette étude lie l’entreprise et la souffrance, considérant que c’est parce qu’il y a travail qu’il y a souffrance. Le travail est source de nos maux : quand il est là, il nous stresse, nous fait souffrir, nous prive de temps et de distractions. Quand il est absent, il est source d’autres maux : précarité, pauvreté, peur de l’avenir, manque de dignité, manque de sens à la vie.
Ainsi le travail est-il perçu comme un supplice et reste donc intimement lié à son étymon tripalium (un engin de torture ou de souffrance) qui n’aurait d’autre usage que celui de satisfaire les besoins primaires (cf. abraham maslow), sans jamais considérer le travail (en tant qu’activité) et l’environnement professionnel (en tant qu’influence) comme des moyens d’expression de la singularité de l’Homme, et un espace potentiellement propice à son évolution.
Culte de la performance
Savez-vous que les gens de grande taille gagnent plus d’argent et réussissent mieux dans leur carrière 2 ? entendez-vous le nombre de chiffres scandés chaque jour par les journalistes, répétés dans les discussions autour de la machine à café ou dans les dîners entre amis ? Le salaire mirobolant de tel grand patron ou sportif, le prix du rachat de telle start-up, le montant d’un déficit : mesurer, évaluer, exposer sa force par les chiffres est l’ordre de notre monde : plus le nombre est élevé, plus tu es puissant.
Il y a chez l’Homme une vraie fascination pour le grand, un besoin continuel de chiffrer, même les comportements ! ainsi observe-t-on par exemple des cadres qui évaluent leurs collaborateurs afin de mesurer leur attitude qui déterminera le versement des primes ou la future promotion.
Pierre de Coubertin prônait la devise olympique citius, altius, fortius (plus vite, plus haut, et plus fort). On pourrait croire que les nombreux addicts au sport (musculation, vélo, trails et autres marathons) sont les relais de ce Coubertin ambitieux pour l’Homme, mais le Baron n’avait probablement pas prévu que lesdits sportifs deviendraient parfois invivables pour leur entourage : nombre de cadres utilisent cet exu- toire jusqu’à mettre en danger leur corps et l’équilibre de leur famille lasse de vivre avec un obsédé de sa propre performance. en réalité, Pierre de Coubertin avait emprunté sa devise sportive à l’abbé didon, et ce citius, altius, fortius se concevait ainsi pour eux : plus vite (athlétiquement), plus fort (intellectuellement et mentalement), plus haut (spirituellement).
La valeur attachée à une action ou à une victoire ne semble pas liée au travail effectué (à sa qualité, sa pertinence, son orientation) mais plutôt à l’effort qu’il a généré.
ainsi, Barack Obama disait après sa deuxième investiture : « nous avons mené un long et dur combat pour arriver à cette victoire, nous nous sommes bien battus. » Lors d’un reportage à la télévision, j’écoutais l’interview d’un joueur de rodéo français, émigré aux États-Unis pour vivre sa passion : « On dira de moi si je meurs : il a morflé, il a souffert, mais au moins il a vécu. » et nos sportifs interviewés après un match, contraints de partager combien ils ont souffert, combien ils se sont battus, combien c’était difficile.
Ce culte de la performance et la mise en scène des efforts fournis m’interpelle : comment se fait-il que le monde de l’éducation se plaigne du manque de capacité à l’effort de leurs élèves ? Comment s’articulent effort, contrainte, et performance ?
Le rapport de force
Le rapport de force est une relation de confrontation entre plusieurs parties en termes de force, que celle-ci soit physique, psychique, sociale, économique, militaire. Si les parties impliquées dans le rapport de force ont un pouvoir inégal, on distingue la partie domi- nante et la partie dominée. Lorsque la partie dominante ne rencontre aucune résistance, on se trouve dans le cadre de la « loi du plus fort », euphémisme pour dire « absence de loi ».
Est-il nécessaire d’indiquer que le rapport de force est probablement vieux comme le monde ? Le besoin de domination participe aux principes de l’évolution, il est souvent indispensable de dominer pour ne pas être dominé et se faire absorber (par une espèce prédatrice, un voisin conquérant, un rival, un concurrent...).
La guerre froide a succédé aux conflits ouverts entre l’est et l’Ouest. Les combats d’épée d’antan ont été remplacés par la guerre des nerfs, et les appétits de domination sont devenus moins visibles, moins grossiers ; il faut désormais une mobilisation et une attention particulières pour dénicher les potentiels prédateurs. il est souvent politiquement incorrect de reconnaître que l’on veut être le plus fort, tout comme il est inavouable d’affirmer son désir de dominer.
Ainsi le rapport de force psychologique s’est-il immiscé dans le monde des idées. S’il se manifestait autrefois par les questions de territoire physique, le rapport de force structure désormais le monde de « qui a raison / qui a tort ». Le désir de domination s’exprime souvent sous la forme d’échanges qui n’ont pas pour but de faire avancer la réflexion mais plutôt de se faire valoir ou se rassurer en tentant de démontrer que sa propre opinion vaut plus que l’opinion de son interlocuteur.
L’entreprise est devenue un lieu de rapports de force, dans un univers où chacun se trouve propulsé par les mêmes raisons et pour le même but : prendre du territoire, gagner du terrain, combattre le concurrent, vaincre le manque de place, de marché, de possibili- tés. La vie professionnelle se prépare dès le collège sur le plan psychologique, et se résume pour beau- coup à acquérir suffisamment d’état d’esprit guerrier pour vaincre l’hostilité de l’entreprise. il s’agit d’être assez combatif pour mener la guerre jusqu’à l’âge de la retraite où l’on pourra enfin « profiter ».
Les plus pugnaces vont alors jusqu’à l’épuisement, le déni du corps, absorbant le stress jusqu’au burn-out ou la dépression. il arrive qu’ils passent de l’autre côté, utilisant leur force contre le mouvement de l’entreprise. ils deviennent aigris, engagés du côté de la revendication et de la plainte plutôt qu’au service de la création de richesse et de mouvement.
D’autres se protègent du danger pressenti en se repliant sur eux-mêmes, ne prenant plus aucune responsabilité, ne s’engageant dans aucune démarche, de peur d’être avalé par la machine à produire.
dans la société ou dans le monde du travail, ces nou- veaux rapports de force qui requièrent davantage d’énergie psychique que physique s’avèrent impitoyables en ce qu’ils ne laissent aucune place à la vulnérabilité ou la fragilité.
Véronique Lorgnier
Si cet extrait vous a intéressé,
vous pouvez en lire plus
en cliquant sur l'icone ci-dessous