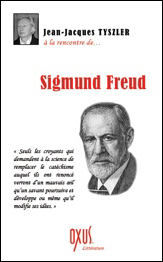A la rencontre de Sigmund Freud
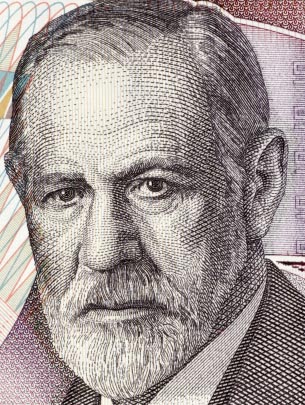
Est-ce le bon moment pour parler de Freud ? Il ne se passe pas une soirée sans qu’un proche me rapporte tel bon mot contre la psychanalyse ou à l’endroit de l’homme Freud directement. J’ai pris l’habitude de faire le gros dos en attendant mais cela insiste et se répète.
J’ai consacré toute ma vie de travail à la psychiatrie et à la psychanalyse, aussi bien en cabinet qu’en pratique institutionnelle. Ce sont des centaines et des centaines d’enfants et d’adultes reçus et accompagnés tant bien que mal. Je crois que toute famille a eu recours à l’écoute bienveillante telle que Freud l’a proposée. Qui n’a pas accompagné son enfant à une consultation ? Qui n’a pas demandé de l’aide pour lui-même, un proche ou encore un parent vieillissant ?
J’ai de ce fait toujours du mal à comprendre la virulence des critiques adressées à la « science de l’inconscient ». Verrait-on une autre discipline attaquée ainsi sur sa compétence et son efficacité ? Verrait-on d’autres scientifiques jetés en pâture dans la presse et les médias comme lors des polémiques récentes sur la question de l’autisme ?
Tout cela paraît normal et plus personne ne s’en offusque.
D’un point de vue factuel, j’ai, comme beaucoup de jeunes de mon époque, rencontré Freud au lycée, au moment du cours de philosophie. Dans mon souvenir, ce fut un véritable choc, le même que celui que j’avais ressenti précédemment en lisant Marx ou Lénine.
Ce n’est pas que ces auteurs semblent partager une certaine vision émancipatrice de l’humanité, et ce, d’autant moins que Freud porte en lui une forme de pessimisme profond quant à la nature humaine. Le choc était plus intime, émotionnel – je pense tout simplement en lien avec l’éclairage sur la sexualité. Un jeune de dix-sept, dix-huit ans est avant tout concerné par son entrée dans la sexualité, et il faut bien dire que Freud raconte à ce propos des choses que l’on ne peut entendre ni lire nulle part ailleurs.
J’ai dévoré les traductions alors disponibles qui me semblaient belles, même si j’ai appris plus tard qu’elles étaient approximatives. Les éditions savantes d’aujourd’hui sont à coup sûr plus exactes, bourrées de notes et de renvois érudits, mais elles n’ont plus le souffle poétique et violent que j’avais trouvé alors.
À côté de la littérature française proposée par les études, je me plongeais dans les grands romans russes dont mon père était friand et qui, à leur façon, comme ceux de l’immense Tolstoï, parlent de l’âme et des passions humaines.
Encore aujourd’hui, la rencontre avec Freud est souvent le bouleversement produit par une seule phrase, une façon de dire comme un coup de poing qui ouvre une brèche, une question qui ne va pas cesser de se poser. Parlant de son identité, Freud dit : « Mes parents étaient juifs, moi-même suis demeuré juif. » Cette seule phrase, apparemment anodine, a toujours ouvert pour moi un abîme, une forme d’évidence et de complexité ; j’aurais pu dire exactement la même.
J’ai connu enfant une forme d’intégration, non pas d’assimilation, de la vie familiale juive à la culture française ; la religion ne tenait pas beaucoup de place, sauf au moment des mariages et des naissances, pour la circoncision des garçons. Nous nous réunissions chaque année lors d’une ou deux fêtes juives au moment du Grand Pardon ou de Pessah. La famille était marquée depuis au moins deux générations par un fort courant de laïcité et d’aspiration sociale qui était plutôt habituel pour des juifs venus de Pologne.
Cette division entre le rappel d’un trait historique de l’identité et la volonté affichée de participer de plain-pied aux idéaux issus de la rationalité semble tout à fait présente chez Freud.
Son article « l’Avenir d’une illusion » consacré à la religion est d’une force incroyable pour un jeune qui cherche ses appuis. Serait-on capable aujourd’hui de parler aussi vertement du fait religieux ?
Je me revois passer sans cesse d’un grand texte comme celui-là, qui touche à des questions philosophiques de fond, ou encore le bouleversant « Actuelles sur la Guerre et la Mort » et ses questions humaines de premier plan, à des textes me ramenant sans cesse aux mystères du sexuel et à nouveau à la rencontre tremblante de mots à peine acceptables tant ils sont gorgés de vérité clinique, tels que dans « la morale sexuelle civilisée » qu’il faudrait distribuer lors de chaque mariage.
Nous n’avions pas dans ces années qui suivaient 1968 le sentiment des appartenances communautaires. Dans mon petit lycée de banlieue, je fréquentais des copains et des copines de toute origine et de toute confession sans même me poser la question de ce type d’appartenance. Nous nous invitions fréquemment dans nos familles respectives sans obstacle apparent. Il est difficile d’expliquer pourquoi nous assistons aujourd’hui chez beaucoup de jeunes à un tel raidissement de l’identité. Les médias et les spécialistes accompagnent ce fait en utilisant comme une évidence des mots dont, adolescent, je n’avais même pas l’usage ; on dit ainsi facilement la « communauté juive » comme si l’on savait ce qu’on désignait par là. Je ne sais toujours pas ce que cela veut dire et j’ai l’impression parfois d’être le seul. Curieusement, c’est d’ailleurs cette même question que m’ont souvent renvoyée mes propres enfants, et plus particulièrement mes filles : « Papa, au fond, pourquoi tu dis que tu es juif ? » C’est à cet endroit que je retrouve l’inspiration freudienne qui m’a immédiatement saisi dans mes années de formation : je porte ce trait, il me guide, je ne sais pas pourquoi ni vers quoi, mais il me guide.
Il va de soi que cette interrogation a nourri des centaines de séances de ma propre psychanalyse. J’ai fait le tour de tous les tourments possibles, en commençant bien entendu par l’exploration de ce qui, dans une famille, faisait répétition – la force du signifiant caché. Cela est bien sûr très partagé, et donc à soi seul nullement explicatif ou définitif, mais mes deux parents ont été durant la guerre ce qu’on appelle des « enfants cachés ». L’un a été protégé par un réseau gaulliste près de Lyon, l’autre par un réseau chrétien à Paris. Il est certain que ces mots et ces circonstances ont toujours marqué mon destin. Et l’on percevra bien que ce qui reste caché, voilé, voire dissimulé, ou encore ce qui chez l’adulte est à jamais trace de ce qu’il a été enfant, ait pu tout spécialement m’intéresser. La psychanalyse est avant tout faite de tout cela, de ce que Freud appelle « névrose infantile ». Mais l’Histoire avec un grand H n’est pas le tout de l’inconscient : par-delà la narration par les miens des grands drames du siècle écoulé (drames qui, il faut bien le dire, restent encore aujourd’hui pour moi totalement incompréhensibles malgré la somme de lectures que j’ai pu en faire), mon intérêt était attiré ailleurs. C’est ce dont Freud prévient : la rencontre pour le petit d’homme, qu’il soit fille ou garçon, est avant tout une rencontre qui sexualise la vie. Freud ne cesse d’en parler, au point qu’on ait parfois pu dénoncer son pansexualisme.
Et donc, ma rencontre avec Freud, dans mon année de terminale, n’aurait probablement pas pu se faire sans que je rêve chaque nuit de la lycéenne dont je tirais, en rêve, méthodiquement les nattes : le hasard a fait que, dans ce petit lycée de banlieue, se distinguait déjà une future actrice connue, déjà à l’œuvre au théâtre, Isabelle Adjani.
Freud le dit et le redit, et, seule au milieu de toutes les sciences humaines, la psychanalyse le dit : ce que nous appelons réalité, ce que nous appelons le monde, tout cela ne peut être lu et reconnu qu’au travers d’une petite fenêtre tout à fait simple, ce que Freud va appeler fantasme. J’ai pu lire Freud et voir s’ouvrir à moi tout un monde, toute une complexité, un éventuel métier à partir de cette petite rencontre érotisée bien que totalement innocente, puisque je n’ai même jamais osé serrer la main ou adresser un sourire à cette jeune lycéenne à la beauté et au talent déjà si affirmés.
Façon de souligner d’entrée qu’en définitive les mots de la psychanalyse, qui paraissent souvent si compliqués, ne sont pas de la théorie, ne sont pas des concepts. Je viens d’évoquer les termes de l’identification et du fantasme, sous un mode d’ailleurs très réducteur ; mais, tout se rejoue toujours, tout est reconvoqué régulièrement au cours d’une vie, et pas seulement lors de l’adolescence.
Un jeune de ma condition sociale était à cette époque, comme je l’ai dit d’emblée, plutôt tourné vers les idéaux d’émancipation ; tous mes amis étaient pour la révolution. Le marxisme était une matière supplémentaire pour chacun de nous et nous étions spécialement studieux à ces cours-là.
Ce qui me frappe avec le recul, c’est qu’il n’y avait pas une rencontre aisée entre Freud et Marx dans la culture de l’époque. Il y avait, je m’en rappelle très bien, de petits groupes militants qui se disaient « freudo-marxistes » et qui étaient aux avant- postes des luttes féministes en particulier, au titre d’une lecture de l’aliénation sexuelle. Mais durant ma carrière militante, entamée dès mes études secondaires, j’ai plutôt le souvenir d’une grande distance vis-à-vis de la psychanalyse, voire d’un rejet, au motif que devant les impératifs de la révolution le nombrilisme et le retour sur soi ne présentaient pas beaucoup d’intérêt.
Il y avait pourtant une grande détresse facilement constatable dans les organisations militantes, beaucoup de jeunes se déracinaient en maltraitant leurs études. Mais c’était, comme on disait à l’époque, « Marx ou crève ! ». Ceux qui, comme moi, se dirigeaient vers la psychanalyse, le faisaient en cachette et assez rapidement étaient vécus comme des faibles, si bien que le divorce était inéluctable.
Pour le dire avec simplicité, voire brutalité, je me demande aujourd’hui si la façon dont la psychanalyse est traitée à la fois par les médias et les politiques n’est pas liée à ce que j’ai vécu plus jeune. Bien des militants que j’ai côtoyés dans les organisations de jeunesse et les syndicats étudiants investissent aujourd’hui la vie publique aux meilleurs postes, ce qui montre d’ailleurs que la dialectique marxiste a été une bonne formation pour devenir député, responsable de grands partis politiques, conseiller du gouvernement et même ministre. Ce vieux divorce entre une lecture marxisante de la société et la psychanalyse a laissé des traces, et la cruauté avec laquelle certains traitent le vieux Freud y trouve partiellement son ferment.
Sans être polémique, il faut ajouter à cela l’antisionisme – disons mal problématisé – des organisations marxistes. C’est un point qu’il est difficile d’expliquer trop succinctement. Je revois adolescent mon père me raconter pourquoi il a déchiré sa carte de militant syndical. Il s’investissait depuis de très longues années dans le combat social, jusqu’au jour où il s’est trouvé à distribuer un tract contre Israël. Mon père n’a jamais été sioniste et s’est toujours montré très critique à l’égard de la politique israélienne quant au problème palestinien. Mais, qu’est-ce qui lui était demandé ? Il avait dit tout simplement, « là, c’est non ». De la même manière, j’ai toujours été interloqué quand les organisations gauchistes déclaraient que l’État d’Israël n’avait pas d’existence légitime. J’hésitais à bien comprendre et étais troublé par le fait que la plupart de leurs dirigeants portaient des noms juifs. Fallait-il rayer l’État ?
On en parle peu aujourd’hui, mais les mêmes aberrations se sont dites, par exemple, au début de l’affaire cambodgienne. Je me rappelle encore de cette question totalement folle : ne devrait-on pas toujours soutenir « un État ouvrier » contre l’impérialisme américain ? Je regrette d’avoir jeté, lors d’un déménagement, tous mes bulletins internes qui racontaient dans le détail cette période dans laquelle une haine profonde se dissimulait derrière des idéaux prétendument révolutionnaires. Je n’ai pas lu grand-chose depuis sur cet aspect des choses mais, si j’en ai la mémoire intacte, beaucoup d’autres parmi les protagonistes pourraient en parler.
Il y a dans la rencontre actuelle avec Freud quelque chose qui ne va pas : la réminiscence d’un rejet que je me dois de rapprocher de cet antisionisme mal analysé.
Freud avertit d’une limite qu’il a bien sûr lui-même vécue de manière paroxystique jusqu’à son départ précipité vers Londres, en laissant néanmoins, ne l’oublions pas, une partie de sa famille aux bourreaux. La psychanalyse pour un jeune de mon époque pouvait apparaître comme une forme d’athéisme accomplie, en finir comme le dit le poète avec « le jugement de Dieu » ; mon propre fils est plutôt sur ce bord, ne faisant pas grand cas des traditions et s’appuyant sur l’espace qu’ouvrent aujourd’hui à la jeunesse les rencontres en Europe ou de par le monde.
Mais Freud prévient d’une difficulté que peut-être, malgré Lacan, la psychanalyse n’a pas pu encore franchir. Lorsque quelqu’un va au bout de la dissolution de tout trait singulier de l’identité, lorsqu’il se déclare porté par une loi universelle, il s’aperçoit souvent que ce vœu va rencontrer un obstacle. Il y a des croisés de l’universel, comme il y a eu des croisés pour les croisades, certains veulent à toute force faire disparaître toute trace de singularité ou tout particularisme.
Il faut se souvenir que cette question n’a précisément jamais pu trouver de solution dans l’histoire du marxisme.
e parti bolchevique, qui tenait ses premières réunions dans le cercle constitué par les ouvriers syndiqués juifs (le Bund) a très vite réclamé la nécessité de la disparition de toute langue trop singulière ; du yiddish donc, en l’occurrence.
Freud a laissé peu de pistes sur la façon dont il a été irrigué par le yiddish ou l’hébreu. Certains historiens ont raconté cela à sa place. Ce qui est sûr, c’est qu’il adorait l’allemand.
Dans une famille comme la mienne, la lettre juive ne se transmettait plus à partir de ma génération. Je l’ai redécouverte avec difficulté et plaisir grâce à la psychanalyse dans l’association dont je fais toujours partie.
Cette place des langues, pour l’inconscient, est capitale pour rencontrer Freud mais on s’en rend davantage compte à partir du retour à Freud qu’a proposé Jacques Lacan. C’est grâce à lui que l’on conçoit mieux la force des différentes langues dans l’inconscient qui ne sont pas toujours d’ailleurs à entendre comme des langues naturelles ; il y a d’autres alphabets qui s’écrivent et dont on peut avoir l’idée, en particulier par l’étude des rêves.
Cette rencontre avec Freud m’a conduit à entamer une analyse relativement jeune, dès mes premières années de médecine.
Un autre courant a été capital, une autre forme de rencontre, celle de la folie, de la psychiatrie. On ne peut immédiatement superposer psychiatrie et psychanalyse. Il faut être respectueux, comme d’ailleurs Freud l’a été en venant à Paris, à la Salpêtrière, aux présentations de Charcot.
La psychiatrie a sa tradition, celle en particulier de l’étude des grandes folies ; partir de ce que dit le fou pour comprendre notre peu d’humanité est une expérience cruciale et définitive pour un jeune en formation.
Il y a une psychiatrie française comme il y avait une grande psychiatrie allemande d’avant-guerre.
Ma rencontre avec Freud s’est redoublée de cette passion qui demeure intacte pour l’école « française » de psychiatrie. Freud a découvert la psychanalyse en écoutant les hystériques.
Sa clé de lecture a toujours été l’hystérie. Ma génération a plutôt suivi le pas de Jacques Lacan dont l’entrée s’est faite par les psychoses et en particulier la paranoïa.
Encore aujourd’hui, lorsqu’on m’interroge, je me déclare psychiatre, psychanalyste.
Jean-Jacques Tyszler
Si cet extrait vous a intéressé,
vous pouvez en lire plus
en cliquant sur l'icone ci-dessous